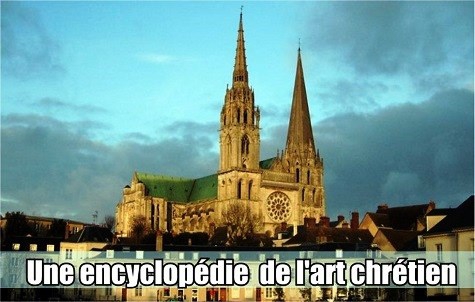Le domaine des sciences dites « humaines » ou « sociales » est souvent le lieu des pires impostures intellectuelles, une sorte de niche pour faussaires académiques que l’université sécrète et subventionne grassement – même si les soi-disant « chercheurs » ne se trouvent guère assez payés – par la manne publique.
Marlène Jouan fait partie de cette imposante cohorte de fonctionnaires rémunérés pour brasser du vent, du moment que celui-ci souffle dans le sens de l’écriture inclusive, des études de genre et, d’une manière générale, du saint progrès, c’est-à-dire, au sens postmoderne du terme, la meilleure façon de marcher sur la tête. Dans une tribune publiée dans Libération (24 octobre), cette « chercheuse » à l’université Grenoble-Alpes soutient, au milieu d’un sabir jargonnant de sociologue en chambre, cette thèse hallucinante qu’in fine, le fait de « porter » un enfant pourrait objectivement s’analyser comme un travail salarié à part entière.
Au prix d’une argutie gauchie et sophistique, la donzelle ose le rapprochement avec les habituelles tâches domestiques qui, venant doubler les journées épuisantes du couple moyen passant la majeure partie de son temps dans l’entreprise, pèseraient davantage sur les femmes. Il s’ensuivrait alors une assignation des tâches qui serait le fruit d’un déterminisme culturel et historique, lequel conduirait généralement ces dernières – notamment lorsqu’elles sont mères – à occuper, à l’extérieur, des emplois quasiment similaires aux activités domestiques ou ménagères, où l’amour rentrerait si peu en ligne de compte comme ces « métiers peu qualifiés et rémunérés de la dépendance et de l’assistance, de la socialisation et de l’éducation : aides ménagères et assistantes maternelles, auxiliaires de vie, aides-soignantes et infirmières, enseignantes du premier degré, secrétaires ». Les nounous agréées et les institutrices apprécieront cette arbitraire condescendance de classe…
À partir de là – si le lecteur, qui se serait involontairement égaré dans le labyrinthe d’un raisonnement spécieux, ne nous a pas lâché en cours de route –, parce qu’un tel état d’inégalité ne paraît pas « nous plonger dans une grande perplexité morale », « l’auteure » sous-entend que ces professions susdites s’apparenteraient à des travaux d’esclaves d’autant plus dégradants qu’ils seraient encore majoritairement occupés par des femmes.
Dès lors, parce que nous ne serions pas choqués par ces emplois domestiques externalisés, nous ne devrions pas l’être, non plus, s’agissant des « mères porteuses », déplorant que « tel qu’il est posé en France, le débat public sur la GPA n’envisage pourtant pas qu’il puisse s’agir d’un travail ». Aussi, argumente-t-elle de plus fort, « comment ne pas reculer devant la GPA […] si le travail qui suit l’accouchement est déjà une “boîte noire” ou un impensé de la maternité ? » En d’autres termes, il convient de dissocier impérativement la maternité de l’amour maternel, condition sine qua non pour accepter socialement la GPA.
Ce faisant, notre « philosophe » de salon milite pour que la GPA « participe à la nécessité de repenser la question politique du travail, de ses définitions et de ses appropriations », sans voir qu’en défendant une telle position, elle tombe dans le travers dénoncé par Marx de l’aliénation, ici, non pas simplement de la force de travail, mais d’un « produit » humain issu d’une pratique mercantile abusivement qualifiée de travail au prétexte qu’une rétribution « éthique » serait versée à la mère porteuse. Or, volens nolens, avec la GPA, l’embryon, réduit à l’état de chose n’ayant qu’une valeur spécifiquement marchande, se trouve étranger à la vie humaine, à ses contingences et à ses aléas. Il est « désessentialisé » et objectivé, résumé à une consomptible valeur d’échange.
Tels sont les délires appointés sur deniers publics de ces universitaires de gauche ayant l’oreille du pouvoir…