Statistiques du corps de l'église:
Congrégations: 2
Prédication stations: 2
Pasteurs nationaux: 2
Vicars: 1
Den Lutherske Forsamling et Avaldsnes;
St. Lukas evangelisk-lutherske forsamling, Stavanger
Informations de contact:
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
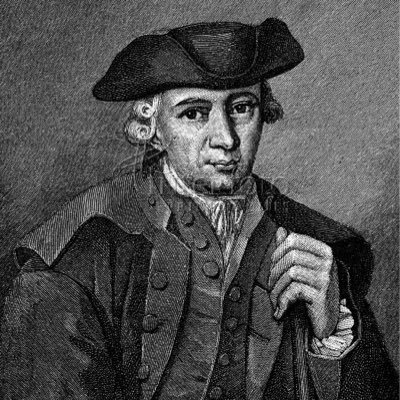
Données clés:
| Naissance |
|
|---|---|
| Décès |
|
| A influencé |
Herder, Friedrich Heinrich Jacobi, Goethe, Hegel, Schelling, Kierkegaard
|
Johann Georg Hamann (27 août 1730 à Königsberg, 21 juin 1788 à Münster) était un philosophe et écrivain allemand.
Son attrait pour l’irrationnel et le langage mystique ou prophétique lui a valu le surnom de « Mage du Nord » (der Magus aus Norden), nom qu’il prenait volontiers lui-même.
Hamann commence des études de théologie en 1746 à l’université de Königsberg, avant de se tourner vers les études de droit. Ses principaux centres d’intérêt restent néanmoins les langues, la littérature, la philosophie ainsi que les sciences naturelles. Il quitte l’université en 1752 sans avoir obtenu son diplôme. Il s’installe en 1757 à Londres où il demeure jusqu’au début de l’été 1758. Il connaît alors une crise profonde, lors de laquelle il étudie intensément la Bible et qui le conduit à une « expérience de l’éveil ».
Hamann fonde le projet d’épouser Katharina Berens, fille du négociant Christoph Berens, mais il ne put y parvenir. Il revient à Königsberg au début de l’an 1759 en raison d’une grave maladie de son père. En dépit de son excellente connaissance des langues, il ne peut enseigner en raison d’un défaut de prononciation, et il doit donc se contenter de professions accessoires tout en exerçant par ailleurs une importante activité d’écriture. Il se lie d’amitié en 1762 avec Johann Gottfried Herder, sur lequel il exerce une grande influence.
Hamann obtient, en 1767 et par l’intermédiaire de Kant, un poste de traducteur auprès de l’administration prussienne des douanes. Il contracte alors un « mariage de conscience » (qui n'a jamais été officialisé) avec Anna Regina Schumacher, dont il a quatre enfants. Son activité professionnelle lui laisse un temps considérable pour l’étude et l’écriture. À partir de 1787, il voyage à Düsseldorf pour y rencontrer Friedrich Heinrich Jacobi, ainsi qu’à Münster où il meurt le 21 juin 1788.
Hamann est considéré comme le prophète du mouvement du Sturm und Drang. Anti-lumières, en opposition aux philosophes des Lumières contemporains (et notamment à son ami Emmanuel Kant), il s'inscrit dans la tradition de Giordano Bruno, Leibniz, Spinoza et du néoplatonisme. Il développe ainsi un intérêt pour les thèmes de la Création ou de l’Incarnation divine, ainsi que pour l’unité de la raison et de la sensibilité, de l’universel et du particulier, du concept et de la perception. Il exerce une influence importante sur la pensée de Herder et de Jacobi, mais également de Goethe, Hegel, Schelling et surtout de Kierkegaard. Au XXe siècle on peut encore trouver une influence de Hamann chez Ernst Jünger qui l'évoque, d'abord en exergue du Cœur aventureux (1929), puis assez souvent dans ses journaux de l'âge mûr.
Convaincu du fait que nos mouvements psychiques s’accomplissent dans quelque chose d’obscur voire d’inconscient, il se crée pour lui-même un nouveau langage, difficilement compréhensible. Il présente la célèbre devise de Socrate « Je ne sais qu’une chose, c’est que je ne sais rien » comme un aveu d’irrationalisme, et il exige de même du penseur et du poète une telle « chaleur de la volonté ». Ses écrits, qui sont généralement brefs, sont ponctués de nombreuses citations et allusions, et sont rédigés dans un style énigmatique qui présente un contraste avec le style simple et limpide de sa correspondance. On a voulu en conclure que l’ambition de Hamann, dans ses écrits, était de « contraindre » son lecteur à un travail actif d’élaboration de la pensée. Auteur et lecteur sont chez lui complémentaires, forment deux moitiés d’un même tout, qui doivent s’adapter l’une à l’autre pour pouvoir rejoindre un but commun.
Cette approche peut à son tour être réinscrite dans son concept central de coincidentia oppositorum (union des contraires), union qu’il cherchait à mettre en évidence, au sein de la vie humaine tout autant que dans les mystères christiques, avec le cas de l’union énigmatique du corps et de l’esprit, de la sensibilité et de la raison, du destin et de la responsabilité. Une telle fascination pour la contradiction l'a conduit à adopter une forte attirance pour l’ironie, dont ses écrits sont constamment empreints et qui a notamment joué un rôle dans l’influence qu’il a exercée sur Kierkegaard.
Les ouvrages les plus importants de Hamann sont Sokratische Denkwürdigkeiten (1759), Golgatha und Scheblimini (1784) ainsi que sa Metakritik über den Purismus der reinen Vernunft (1784).
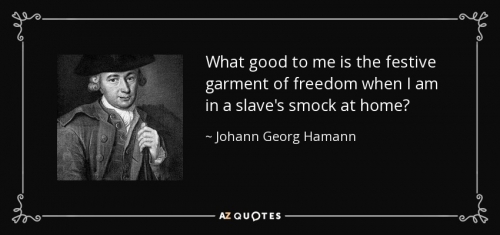
09:20 Publié dans Culture | Lien permanent | Commentaires (0)

Den Lutherske Bekjennelseskirke, l'église confessionnelle luthérienne en Norvège, a vu le jour en 1978. Un groupe de croyants était de plus en plus troublé par la situation dans leur église nationale, luthérienne de nom, une église populaire qui tolérait les enseignements et pratiques non bibliques. Combien de temps pourraient-ils rester membres là-bas? Que devraient-ils faire?Où pourraient-ils aller? L'aide provenait du pays voisin, la Suède, où une église confessionnelle luthérienne avait été fondée en 1974. Grâce à l'Institut Biblique pour la recherche biblique et à son directeur, le Dr Seth Erlandsson, les Norvégiens furent grandement renforcés. Ils ont reçu une instruction solide dans de nombreuses vérités bibliques importantes, telles que la doctrine de la justification par la seule grâce, et les principes de la communion ecclésiale.
Deux nouvelles congrégations ont été fondées à Avaldsnes et Stavanger sur la côte sud-ouest de la Norvège. Dès le début, ils étaient membres de l'Église confessionnelle luthérienne centrée en Suède (qui avait également des membres en Finlande). Cependant, depuis 2009, les congrégations norvégiennes ont été organisées en tant qu'organe indépendant de l'église norvégienne tout en maintenant des liens étroits avec les églises sœurs en Suède et en Finlande.
Les membres de l'Église confessionnelle luthérienne de Norvège se réunissent régulièrement pour des services religieux, des études bibliques pour jeunes et moins jeunes, des cours de confirmation et des chants de choeur. Dans tout ce que nous faisons, nous voulons nous concentrer sur l'Évangile de Jésus-Christ et le salut qu'il a gagné pour tous les peuples. Nous invitons tout le monde à venir entendre le merveilleux message de Dieu, qui nous a été donné par son mot verbalement inspiré, inerrant et autoritaire. L'église publie son propre magazine, Bibel og Bekjennelse (Bible et Confession), qui est également lu par de nombreux non-membres, ainsi que d'autres documents imprimés, des livres et des brochures en langue norvégienne.

09:51 Publié dans Apolégétique | Lien permanent | Commentaires (0)
| Wittemberg Lutherstadt Wittenberg |
||||||||||||
 Héraldique |
||||||||||||
| Administration | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays |  Allemagne Allemagne |
|||||||||||
| Land |  Saxe-Anhalt Saxe-Anhalt |
|||||||||||
| Arrondissement (Landkreis) |
Wittenberg | |||||||||||
|
||||||||||||
09:17 Publié dans Apolégétique | Lien permanent | Commentaires (0)
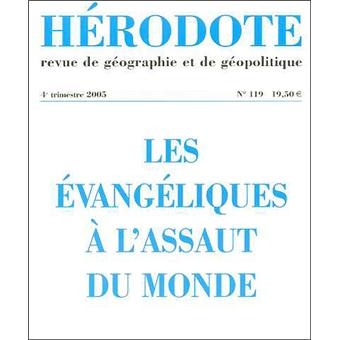
Le fondamentalisme chrétien désigne une position religieuse qui soutient une interprétation stricte et littéraliste de textes sacrés1,2, qui est surtout présente dans le protestantisme3. Il signifie également, dans un sens plus général, une adhésion rigide aux principes fondamentaux d’un domaine quelconque3. Ainsi, le fondamentalisme se manifeste par un engagement envers des doctrines radicales et peu nuancées, généralement religieuses4, mais aussi séculières5,6 ou même anti-religieuses7. Par exemple, ce mot est aussi employé pour désigner une conception scientiste8,9,10 de l'existence ou un absolutisme dans les domaines philosophique11, moral ou économique12. Le fondamentalisme cherche à justifier une conception du monde répondant à un besoin de sécurité intellectuelle et existentielle13, une reconnaissance identitaire14 ou à faire prévaloir un pouvoir politique, communautaire ou religieux15.
Ce courant de pensée s’est développé au début du xxe siècle en terrain évangélique nord-américain, en opposition aux développements du libéralisme théologique16, et surtout contre l’exégèse historico-critique qui s'était développée dans le protestantisme dès le xixe siècle17. Le fondamentalisme religieux ne recherche pas nécessairement un retour aux fondements de la religion dont il est issu, mais plutôt à ceux que ses adeptes considèrent comme tels18. Au contraire, ceux-ci en détournent le sens19, du moins celui donné par les grandes Églises, dans le but de le rendre conforme à leur a priori idéologique20. Par contre, le fondamentalisme traverse toutes les Églises et se concentre dans quelques-unes21. Le sociologue Émile Poulat estime que le fondamentalisme n’est pas organisationnellement une secte mais « intellectuellement c’est une secte sans aucun doute »22. Par ailleurs, Sébastien Fath, chercheur au CNRS, considère que la violence « ne représente pas un trait commun aux divers fondamentalismes. La violence religieuse n'est pas toujours fondamentaliste, et tous les fondamentalistes sont loin d'être violents »4. Toutefois, ceux-ci montrent une radicalité qui tend vers l'intolérance4. Ainsi, les fondamentalistes sont persuadés qu’ils sont les seuls détenteurs de la vérité4,23.
Le fondamentalisme se distingue par l’absence d’esprit critique24. Ainsi, le doute, qu’il soit d’ordre spirituel, existentiel, ou méthodologique n’y est ni désiré, ni valorisé et il doit être dissipé25 pour faire place à une certitude intérieure26,27. C’est pourquoi le fondamentalisme s’oppose généralement à l’exégèse historico-critique ou scientifique, qui est adoptée officiellement par les Églises non fondamentalistes pour interpréter les textes religieux. Le fondamentalisme n’admet qu’une lecture au premier degré28 des textes sacrés, découpés en extraits cités hors contexte historique, culturel et littéraire29, comme si ceux-ci étaient des écrits contemporains et occidentaux : le fondamentalisme « s'oppose à toute interprétation historique et scientifique et s'en tient au fixisme »18.
Le fondamentalisme religieux se caractérise également par l’hétéronomie30,31 c’est-à-dire une dépendance et une soumission32 à des textes religieux, qui sont lus hors contexte et au premier degré28. Cette hétéronomie s’étend à la soumission à des autorités religieuses, civiles ou politiques33. C’est pourquoi, écrit Sébastien Fath, « l'autorité normative, qu'elle soit placée dans une tradition, un leader, ou dans un texte, constitue un trait fédérateur pour tous les mouvements religieux radicaux. […] Ainsi, l'idée d'une autonomie individuelle qui puisse se passer de la norme divine apparaît insupportable aux fondamentalistes »4. De plus, le fondamentalisme peut se traduire par un comportement d'exclusivisme, d'isolation, voire d'antagonisme défensif ou conquérant avec qui ne partage pas l'absolutisme34 de son idéologie, aussi bien vis-à-vis des coreligionnaires non fondamentalistes35que des membres des autres confessions ou de non-croyants.
Le terme « fondamentalisme » est originaire d'Amérique du Nord d'où proviennent aussi les principales études qui ont tenté de définir et d'analyser ce phénomène36. Au sens strict, ce mot ne devrait désigner que le fondamentalisme protestant, mais il en est venu, en France, à viser surtout les islamismes radicaux qui occupent dans ce pays plus de place dans les débats que les protestantismes radicaux37. Depuis la fin des années 1970, la signification de ce mot s’est élargie constamment: on parle maintenant non seulement de fondamentalisme protestant ou islamique mais aussi de fondamentalisme juif, catholique38, bouddhiste39, hindou, sikhiste40, païen41, laïque42 et de fondamentalisme athée43,44,45. Il a donc maintenant une signification étendue et éparse. C'est pourquoi le sociologue Émile Poulat souligne que ce phénomène est « difficile à enfermer dans une définition : on ne peut que le décrire, du moins en première analyse46. Le fondamentalisme se retrouve également dans la frange la plus conservatrice des grandes religions chrétiennes même si celles-ci ne sont pas fondamentalistes47 .
Le fondamentalisme se manifeste par un état d’esprit, une mentalité48 et plusieurs positions doctrinales en découlent, de sorte qu'il n’existe aucune raison de réserver ce terme aux mouvements religieux5.
La typologie utilisée vise à présenter ces positions et non à classifier ou à qualifier des Églises et des groupes. Il n'existe pas un seul type de fondamentalisme chrétien ou de quelque autre autre religion. Le sociologue des religions Jean Baubérot affirme que «le fondamentalisme est multiple et compte de nombreuses orientations, le plus souvent très différentes, mais qui parfois se retrouvent sur des positions de refus. Un seul exemple pour illustrer ce pluralisme : le thème du retour du Christ est à l'origine de diverses tendances post-millénaristes, prémillénaristes, amillénaristes ; sans accord entre elles »49.
Enfin, on ne peut bien saisir les divers fondamentalismes sans les juxtaposer aux grandes religions ou idéologies dont ils sont issus. C’est pourquoi une méthode de corrélation entre les traits essentiels des divers fondamentalismes et les doctrines libérales opposées devrait être utilisée pour les mettre en lumière.
Le concept de fondamentalisme a été étendu à des domaines hors du champ religieux, dans un sens proche du radicalisme. Ainsi, Maurice Merchier avance que le fondamentalisme peut être économique, voire démocratique50. Il peut également être scientifique51.
Le fondamentalisme chrétien « est caractérisé par son opposition radicale aux orientations théologiques des grandes Églises »52. Dans son ouvrage « Fundamentalism », James Barr23 mentionne trois traits du fondamentalisme chrétien tout en précisant que cela ne suffit pas à le définir : « (a) un accent très marqué sur l'inerrance de la Bible, l'absence en elle de toute sorte d'erreur (l’inerrance) ; (b) une forte hostilité à la théologie moderne et aux méthodes, résultats et implications de l'étude scientifique et critique de la Bible; (c) une assurance que ceux qui ne partagent pas leur point de vue religieux ne sont absolument pas de "vrais chrétiens" »53. Pourtant, James Barr affirme que le fond de l'attitude fondamentaliste ne réside pas dans la Bible. Pour lui, la notion d’inerrance biblique reste secondaire : « […] le cœur du fondamentalisme est un certain type de discours, une manière de parler qui détient l'autorité réelle »54. L’inerrance biblique et la lecture des textes religieux servent de bouclier pour justifier un « a priori » idéologique ou une arrière-pensée ultra conservatrice et radicale. D’autres caractéristiques du fondamentalisme sont spécifiques à certains groupes55.
Les précurseurs du fondamentalisme sont pour la plupart issus des remous qui ont suivi la Réforme protestante, dont les protagonistes (catholiques ou protestants) furent libérés de la mainmise de Rome concernant l'accès direct à la Bible et à son interprétation56. Vers 1670, on voit apparaître le piétisme57. Des protestants commencèrent à se réunir pour étudier la Bible et prier sous l’influence du pasteur Philipp Jacob Spener56. Chez les catholiques, vers la même époque, le quiétisme puis le jansénisme suivent des voies parallèles à celle du piétisme protestant et ces mouvements s'influencent mutuellement58 : on y retrouve Fénelon, la célèbre Madame Guyon et Pascal. Ce dernier, favorable au jansénisme, en devint l'un des meilleurs défenseurs. Il a écrit : « C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c'est que la foi, Dieu sensible au cœur, non à la raison. » Il résumait là l’essentiel du piétisme tout en le revendiquant59. Encore maintenant, on peut observer cet aspect piétiste dans la pensée fondamentaliste56.
L'évangélisme fondamentaliste puise dans le piétisme20 pour former un courant constitué par couches successives de « réveils »60,61. Ces « Réveils » spirituels s’expriment lors de rassemblements à forte composante émotionnelle destinés à faire ressentir la puissance de Dieu, par exemple les camp meetings qui durent plusieurs jours. Le pasteur, instruit ou non, manifeste une passion communicative62. De tels mouvements existent en milieu protestant américain depuis les années 186062.
Le fondamentalisme fut nommé ainsi pour la première fois lors des réunions de la « Niagara Bible Conference » (1878-1897) et il prit son essor en milieu protestant aux États-Unis, au début du xxe siècle, par la diffusion des brochures populaires de la conservatrice Northern Presbyterian Church, lesquelles ont défini les « fundamentals »63,64, auxquels le millénarisme a été ensuite ajouté. La diffusion abondante de ces « Fundamentals » explique davantage l’appellation du fondamentalisme que ses causes profondes. En effet, le fondamentalisme chrétien moderne provient essentiellement de réactions : il se dresse contre la philosophie des Lumières, contre le rationalisme anglais du xviie siècle, contre l’Aufklärung du xixe siècle, contre le libéralisme de la modernité, contre l’exégèse historico-critique et scientifique et surtout contre la théologie libérale du XXe siècle65.
Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que des Églises protestantes se donnèrent elles-mêmes le nom de « fondamentalistes ». Aujourd'hui, le mot « fondamentalisme » a une connotation péjorative. Ses adeptes préfèrent qu’on les nomme « Conservative Evangelicals », une expression « qui n’est pourtant pas équivalente »66.
Les fondamentalistes s’opposent à la théologie du xxe siècle, la jugeant trop intellectuelle et déviante67. L’historien George Marsden affirme que l’essor du fondamentalisme aux États-Unis s’explique surtout par les réactions contre « les développements remarquables » de la théologie du xxe siècle68. Le théologien Luc Chartrand note que « ce phénomène est caractérisé par son opposition radicale aux orientations théologiques des grandes Églises »69. « Se méfiant de l'intelligence humaine qui perce difficilement les réalités spirituelles, écrit-il, ils [ les fondamentalistes ] tiennent pour suspectes la critique théologique et la recherche intellectuelle en général. […] Dans ce contexte on lira donc la Bible en se méfiant de l'intelligence, l'essentiel étant constitué par la religion du cœur »56,59.
Le fondamentalisme est apparu comme un mouvement d’opposition non seulement contre l’exégèse scientifique, mais aussi contre la théorie de l’évolution, l’évangélisme social et les doctrines non orthodoxes, perçus comme les symptômes d’un monde pécheur et corrompu70. Il se décline presque toujours sur fond conflictuel71,72. Par contre, il ne rejette pas toute la modernité mais seulement le libéralisme qu’elle véhicule73. Parce que les uns deviennent les hérétiques des autres, les fondamentalistes « s'orientent nécessairement vers une dynamique d'oppositions et d'exclusions multiples »74.
L’isolationnisme propre aux fondamentalistes se manifeste par une répulsion contre l’humanisme séculier75, et parfois le rejet de l’école publique qui, pensent-ils, ne transmet pas leurs valeurs chrétiennes fondamentales76,77.
Position des Églises non fondamentalistes
La théologie du xxe siècle s’est déployée en milieu universitaire, ainsi qu’à l’intérieur de l’Église catholique et des Églises protestantes non fondamentalistes. Malgré l’indépendance universitaire des facultés de théologie, des formes d’association et de consultation avec les théologiens des grandes Églises ont été établis78.
L’inerrance de la Bible et sa lecture au premier degré supposent, comme postulat, qu’elle soit exempte d'erreur et fiable à tous égards79; dans la pensée fondamentaliste, la Bible doit être comprise et ses préceptes mis en pratique de manière uniforme à toute époque et en toutes circonstances, sans égard à la culture, au contexte et aux genres littéraires qui ont marqué les auteurs des textes bibliques80,81 dans les mots mêmes de la Bible, tout au moins dans ses « manuscrits originaux ». Selon l'exégète Sophie Raymond de l'Institut catholique de Paris, une telle lecture faite sans méthode historico-critique permet « de dire n’importe quoi »82 et conduit à travestir les textes sacrés dans un but idéologique ou selon un a priori théologique83,84. Selon le théologien Luc Chartrand, le fondamentalisme « refuse catégoriquement toute méthode exégétique scientifique — de la simple connaissance des genres littéraires, aussi bien que de l'intention de l'auteur jusqu'aux formes les plus complexes de l'exégèse moderne avec le développement de la critique littéraire — stérilisant ainsi toute recherche exégétique et, surtout, toute compréhension des textes sacrés »85.
Les fondamentalistes ne voient aucune difficulté à découper des extraits, à les lire hors contexte, et à faire abstraction de toute exégèse ou herméneutique pouvant les situer correctement et les interpréter86. Ils rejettent le symbolisme de la bible et ce que la théologie moderne considère comme un principe d’interprétation essentiel, à savoir que les symboles forment le langage religieux et portent la puissance du message biblique : le symbole est le doigt qui pointe vers l’absolu, l’infini, mais le lecteur au premier degré ne regarde que le doigt87. Le Conseil international pour l'inerrance biblique a publié en 1978 une première déclaration dont les articles XII et XIII « affirment l'inerrance de la Bible dans "son intégralité" […] l'inerrance des énoncés dans Genèse 1 à 11 (l'histoire de la création, du déluge, de la tour de Babel et l'origine des différentes nations) est clairement affirmée, et les "illégitimes hypothèses scientifiques sur l'histoire de la terre sont catégoriquement rejetées". L'inerrance, en terme technique, signifie "l'entière vérité de l'Écriture", et cela touche également "les problèmes de grammaire et d'orthographe,... les phénomènes de la nature... »88.
Les méthodes historico-critiques89 de l'exégèse biblique ont été initiées au xviiie siècle avec les Lumières et développées par le protestantisme allemand à partir du xixe siècle, avec le progrès des sciences humaines. Cette nouvelle exégèse « portera souvent la marque des philosophies dominantes, qu’il s’agisse de celle de Hegel ou plus tard du positivisme »90. Les Églises protestantes non fondamentalistes ont encouragé ces développements alors que les autorités catholiques y sont restées rétives jusqu’au début du xxe siècle90. Selon le théologien protestant André Gounelle, la Bible ne proclame pas sa propre infaillibilité91.
Selon l'Église catholique, les auteurs bibliques ne cherchaient pas à éviter des erreurs et des contradictions, qui demeurent sans lien avec l'inerrance biblique, puisque celle-ci ne concerne que le message spirituel qu'ils voulaient transmettre92. En 1943, l’Église catholique s’est officiellement ralliée à la méthode scientifique historico-critique. L'encyclique Divino afflante Spiritu de Pie XII encouragea les méthodes critiques d'exégèse et le recours aux sciences utiles à l'interprétation de l'Écriture. En 1965, le texte conciliaire Dei Verbum, adopté lors de Vatican II, fit en sorte que l’exégèse de type scientifique soit axée sur recherche de l'intention de l'auteur biblique et la détermination des genres littéraires, compte tenu des conditions de son époque et de sa culture. La recherche du sens spirituel demeurera également essentielle93.
D’autre part, le théologien catholique Luc Chartrand considère que « la lecture fondamentaliste de la Bible ne peut être acceptable de la part d'un catholique »94. Par cette lecture, selon lui, les mêmes mots lus par des personnes différentes ne font alors que refléter la pensée du lecteur.
Le fondamentaliste a pour assise une foi qui relève de la volonté et de l’affectivité. La foi de celui-ci se traduit par une ferme adhésion qui ne doit laisser subsister aucun doute95. Face aux complexités changeantes de la vie moderne, au sécularisme humaniste et aux incertitudes politiques et économiques, le fondamentalisme offre une explication qui satisfait aux besoins de sécurité et de stabilité96. C’est pourquoi il se retrouve parmi les groupes les plus conservateurs de la société97.
La position de l’Église catholique est résumée dans son Glossaire, qui définit le doute : « Interrogation caractérisée par l’hésitation et la perplexité. Les personnes qui doutent se rencontrent chez les croyants, non chez les incrédules. Douter peut se situer à l’intérieur d’un cheminement spirituel et permettre de progresser dans « l’intelligence de la foi » car la foi et le doute ne se contredisent pas fondamentalement »98. Le théologien Pierre Lathuilière souligne qu’il « ne s'agit nullement de mettre le vécu de la foi hors de portée des critiques et des assauts du doute ». Il cite Sulivan : « Toute certitude est mise à mort de Dieu. L'athéisme classique a ses racines dans les certitudes »99.
Il en est de même de la position des Églises protestantes non fondamentalistes. Ainsi, le théologien et philosophe protestant Paul Tillich conçoit la foi comme la préoccupation ultime de chacun: elle ne relève, selon lui, ni de la volonté ni de l’émotion. L’objet de cette priorité existentielle (qu'il s'agisse de Dieu, du matérialisme, du succès, du pouvoir etc.) devient le Dieu de chacun, de sorte que le doute porte sur le « risque » du choix, pour une vie réussie, d'une telle préoccupation ultime. Ainsi, affirme-t-il, le doute est assumé par le « courage d'être »100,101 et non par la volonté ou l’affectivité. Ces dernières ne précèdent pas la préoccupation ultime mais la mettent en œuvre102.
Le fondamentalisme adopte l’une ou l’autre de ces trois positions pour définir la relation entre sa pensée et les théories scientifiques : l’anti-scientisme, le fidéisme ou le concordisme103. L’anti-scientisme, dont fait partie le créationnisme, consiste à nier les théories et découvertes scientifiques, telle que l’évolution103. S’en tenant à la vérité d’une lecture « fondamentaliste » de l’Écriture, le créationnisme conteste les résultats scientifiques concernant l’âge de l’univers et l’évolution des espèces103. Par ailleurs, les fidéistes ne nient pas les résultats scientifiques, mais soutiennent que la « conviction et l’abandon du cœur, devraient se situer dans des voies séparées et surpasser la raison »104,105, comme le croyait Pascal59 ». Il propose l'autonomie des deux savoirs correspondants qui ne se rencontrent jamais105. Le fidéisme s’oppose donc à la théologie naturelle et à la philosophie de la nature. Le concordisme recherche honnêtement la vérité scientifique mais suppose que les récits bibliques sont en accord avec la science. Il cherche à faire coïncider les résultats scientifiques avec le donné biblique compris de manière quasiment littérale106.
Pour une grande partie des groupes fondamentalistes, l’une des principales fonctions de la religion et du sacré consiste à expliquer l'univers et les phénomènes naturels : La Genèse n’est pas considérée comme un mythe symbolique de la création mais comme une description d’événements historiques et causals107,108.
Le catholicisme ne considère pas la création comme une notion explicative et causale de l’univers109comme s’il s’agissait d’un concept scientifique, mais comme le symbole de l’état de finitude des êtres humains dans une relation d’alliance avec l’infini ou l’absolu110 ; la création est perçue comme principe de l’existence plutôt que néant111,112. Ainsi, Dieu se présente comme radicalement différent de la nature113. L'Église catholique définit la création « comme le commencement de l’histoire du salut qui culmine avec le Christ. Ce n’est pas un évènement du passé, mais un évènement toujours actuel qui se renouvelle à chaque instant et conduit l’homme vers son accomplissement »114.
À l’âge préscientifique, seuls les mythes pouvaient donner une explication de l’univers115 et lorsque la science moderne est apparue avec Galilée et Newton, il y eut confusion des genres, ce qui a laissé l'Église à l'écart du mouvement de la révolution copernicienne. Pourtant, l’interprétation symbolique de la création dans la Genèse n’était pas nouvelle. Déjà au iiie siècle, l’un des Pères de l’Église, Origène, considéré comme le fondateur de l'exégèse biblique, montrait toute l'absurdité116 d'une lecture au premier degré de la Genèse et, par anticipation, il rejetait le créationnisme.
Les Églises protestantes ont des sensibilités et des théologies différentes ; en général, les églises protestantes traditionnelles (luthériennes, réformées,...) ne sont pas fondamentalistes et considèrent le terme biblique « création » comme un concept théologique117,118 et philosophique119,120. Paul Tillich appelle « mythe brisé » le mythe qu’on comprend comme étant bien un mythe, mais qu'on voit aussi comme le symbole d'une réalité ultime, indicible autrement. Il affirme que « par sa nature même, le christianisme refuse tout mythe non brisé, parce qu'il présuppose le premier commandement : l'affirmation de l'ultime en tant qu'ultime et le rejet de toutes les formes d'idolâtrie quelles qu'elles soient ». On devrait reconnaître, expose-t-il, tous les éléments mythologiques dans la Bible, la doctrine et la liturgie pour ce qu'ils sont, et les maintenir dans leur forme symbolique sans les remplacer par des substituts scientifiques »121.
Paul Tillich122 soutient que « ce qui concerne l’homme ultimement doit s'exprimer symboliquement parce que seul le langage symbolique123 a la capacité de dire l'ultime. Dans la religion, le véritable ultime « transcende infiniment le domaine de la réalité finie; aucune réalité finie ne peut donc l'exprimer directement et littéralement. Il considère le mythe ou le symbole comme une forme puissante de langage, qui reste la seule à pouvoir exprimer l’indicible, l’infini ou l’ultime120.
Selon le théologien luthérien Gérard Siegwalt124, la relation de dépendance de l’univers et de l’humain à l’égard de Dieu exprime le concept philosophique de contingence125. Il soutient qu’« on ne doit pas concevoir Dieu comme le « Grand Horloger », « le Grand Architecte de l’univers » : Selon l'authentique conception de la création biblique, pense-t-il, Dieu n'est pas derrière la nature ni avant la nature; il est dans la nature. Ainsi, selon l’auteur, la foi en la création consiste en la prise de conscience du caractère divin, sacré, de la nature. Le Créateur est le Dieu du tout, pour autant qu'il est le fondement ontologique de tout ce qui est, c’est-à-dire la dimension dernière du réel126
Une morale hétéronome (heteros : autre et nomos : loi) est littéralement la loi d’un Autre, c’est-à-dire, Dieu ou ses représentants. Pourquoi agir moralement ? La réponse fondamentaliste est simple : La transcendance le commande127 et dicte à l’homme ses normes128 et sa conduite. Cette soumission à la volonté divine est une morale de l'hétéronomie129. Elle est associée à une forme de sotériologie129 selon laquelle le salut consiste à éviter la damnation et à obtenir des récompenses ou la béatitude. Un spécialiste des fondamentalismes chrétien et islamique, David Zeidan, écrit que les fondamentalistes considèrent l'Écriture comme une transcription fidèle et littérale de la vérité révélée par Dieu et en conséquence, les êtres humains n'ont plus qu'à l'accepter, s'y soumettre et obéir129.
Guy Durand, spécialiste en éthique et professeur émérite de l'Université de Montréal, distingue deux types de morale religieuse, l’une hétéronome et l’autre autonome130. Il explique que l’hétéronomie « fait largement appel à l'obéissance des fidèles parce que le précepte est rattaché directement à Dieu par l'intermédiaire des autorités. C'est le modèle conservateur adopté généralement par les sectes ; on le trouve également dans les courants fondamentalistes de toutes les grandes religions: catholique, protestante, juive, musulmane, hindoue ou autres. Une morale religieuse autonome, au contraire, mise résolument sur l'intelligence humaine »131. C’est pourquoi, écrit Sébastien Fath, « l'autorité normative, qu'elle soit placée dans une tradition, un leader, ou dans un texte, constitue un trait fédérateur pour tous les mouvements religieux radicaux. […] Ainsi, l'idée d'une autonomie individuelle qui puisse se passer de la norme divine apparaît insupportable aux fondamentalistes »4.
Selon L’Église catholique et les Églises protestantes non fondamentalistes, l'Évangile insiste sur la primauté de la conscience individuelle sur l'observance littérale de la loi132 : « Tout ce qui ne se fait pas par conviction est péché »133. Le théologien Luc-Thomas Somme explique la position catholique, exprimée lors du Concile Vatican II (Constitution Gaudium et Spes, no. 16, promulguée par le pape Paul VI) :
« Et s'il arrive qu'elle [la conscience] se trompe de bonne foi, elle ne cesse pas de constituer la norme impérative de la moralité, en sorte que lui désobéir même en ce cas constitue une faute. Ne pas suivre sa conscience, même erronée, est donc toujours un péché. En revanche, lui obéir quand elle se trompe n'excuse du mal commis ou du bien omis que si l'erreur est en tout point involontaire et elle-même non coupable »134. Le sociologue des religions Sébastien Fath, écrit que « l’autonomie de la conscience morale est un trait essentiel de la rupture [du christianisme] avec le judaïsme. Elle n’est pas aperçue ou acceptée par les fondamentalistes »4. En christianisme, le « commandement » prend un sens particulier parce qu’il doit céder le pas devant le jugement de la conscience droite. C’est pourquoi l’Église catholique, se fondant sur le Nouveau Testament132, considère les « commandements » (de Dieu ou de l’Église) comme « un appel à l’amour et à la liberté » et une « forte recommandation »135. Ainsi, la notion chrétienne de « commandement » dérive du judaïsme, mais sans conserver le même sens.
De même, le philosophe non croyant Luc Ferry considère que le christianisme est « une religion de l’esprit plus que de la lettre, une religion de la conscience et de la liberté intérieure », ce qui a permis le passage à la laïcité136. L'exercice de valeurs morales, que leur source soit éthique, séculière ou évangélique, n'est pas hétéronome s'il procède d'un acte libre.
Enfin, Paul Tillich affirme que « l'hétéronomie représente, en général, une réaction contre une autonomie ayant perdu sa profondeur, devenue vide et impuissante. Mais, en tant que réaction, elle est destructrice, car elle refuse à la raison le droit à l'autonomie et en démolit du dehors les lois structurelles »137. Ce théologien et philosophe croit plutôt en une rencontre de la volonté humaine et de la volonté divine, dans une alliance ; ce qui évoque le prophète Jérémie (31, 33) : « Mais voici en quoi consistera l’alliance que je conclurai […] : j’inscrirai mes instructions non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience; je les graverai dans leur cœur ».
Le « Fundamentalism Project » contient une étude de l'historien et théologien Pablo A. Deiros portant sur le fondamentalisme protestant en Amérique latine; il se réfère à l’épître de Paul aux Romains pour expliquer la conscience politique hétéronome des fondamentalistes33 : « Que chacun se soumette aux autorités en charge. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont constituées par Dieu. Si bien que celui qui résiste à l'autorité se rebelle contre l'ordre établi par Dieu. Et les rebelles se feront eux-mêmes condamnés. […] Veux-tu n'avoir pas à craindre l'autorité ? […] elle est un instrument de Dieu pour faire justice et pour châtier qui fait le mal. Aussi doit-on se soumettre non seulement par crainte du châtiment, mais par motif de conscience » (Épître de Paul aux Romains, 13, 1-6.).
Lu hors contexte et sans méthode historico-critique, des fondamentalistes enseignent que l’une des fonctions de la religion consiste à justifier et solidifier l'ordre politique, soit le « théologico-politique »127. Pourquoi obéir à la loi ? Parce que tout pouvoir vient de la transcendance33. Ainsi, selon Pablo A. Deiros, le fondamentaliste cultive un état d’esprit voulant que toutes les autorités soient instituées par Dieu. Et il croit que Dieu remplacera les autorités qui ne pratiquent pas la justice33.
L’Église catholique et les Églises protestantes non fondamentalistes soutiennent qu’on doit rechercher l'intention de l'auteur par le contexte historique, l'ensemble des textes connexes, le genre littéraire et accorder une grande importance au sens spirituel138. Selon ces Églises, l’épître de Paul aux Romains (Rm 13, 1-6), qui demandait une soumission aux autorités de Rome fut un appel au respect de la loi, adressée aux premiers chrétiens de Rome dans un contexte de persécutions. Alors que la perspective fondamentaliste y perçoit une règle applicable pour toute l'humanité, en toutes circonstances et à toute époque, les grandes Églises chrétiennes, comme l'indique le théologien Pablo Deiros, voient son sens spirituel, révélé par Romains (Rm 2,14 à 13,8) : « Celui qui aime les autres a obéi complètement à ce qu’ordonne la loi »33,127,130.
Selon le philosophe et théologien protestant Paul Tillich, dans le domaine politique, la liberté est principe de créativité sociale, ce qui signifie transformation pour le mieux. Il précise : « La démocratie tend vers un système de participation pour tous ; elle prévient ainsi la déshumanisation que produit la tyrannie »139.
Le millénarisme est une position minoritaire dans l’éventail du fondamentalisme protestant, même s'il a fait partie des croyances fondamentales de l'adventisme. Ses défenseurs croient avoir découvert des vérités oubliées depuis très longtemps concernant le sens caché des prophéties bibliques, lesquelles seront bientôt accomplies. Le pré-millénarisme est la croyance que le mal envahit le monde de plus en plus et que Jésus viendra pour emporter avec lui les vrais croyants. Puis, il y aura sept années de grandes tribulations où régnera l'Antéchrist. Jésus reviendra ensuite gouverner la terre pendant mille ans. Les post-millénaristes croient plutôt que le monde continuera à progresser et que le bien l’emportera sur le mal. Le dispensationalisme présente une vision de l'histoire du salut qui divise l’histoire en sept dispensations ou « attitudes » de Dieu face à l'humanité. Le dispensationalisme situe les vrais croyants avant la septième dispensation, le moment où le Christ soustraira son Église invisible aux malheurs et tribulations du monde. Ces croyances détournent le sens spirituel des textes pour se fonder sur un biblicisme littéraliste. Pierre Lathuilière y décèle un « mal d’être au monde »140.
L'Église catholique et les grandes Églises protestantes rejettent ces doctrines, même si Pierre Lathuilière remarque une « surchauffe eschatologique » parmi certains de leurs adeptes140.
Le fondamentalisme refuse généralement le dialogue avec des doctrines différentes. Comme il soupçonne les autres croyants de n’être pas convertis, il refuse l’œcuménisme car il craint toute compromission avec eux141. Il ne voit aucune raison de chercher un dialogue avec des gens qui ne sont pas vraiment chrétiens142,143.
L’œcuménisme est un mouvement interconfessionnel, né en milieu protestant, qui tend à promouvoir des actions communes entre les divers courants du christianisme, en dépit de leurs différences doctrinales, avec pour objectif l’unité visible de l’Église. En 2013, Conseil Œcuménique des Églises comprenait 345 Églises, dénominations et communautés d’Églises de 120 pays, représentant plus de 500 millions de chrétiens répartis à travers le monde.
Selon l’Église catholique, l’œcuménisme désigne « l’effort des chrétiens pour parvenir à une unité institutionnelle entre les différentes Églises et communautés qui le composent aujourd’hui. L’Église catholique ne rejoignit officiellement le mouvement pour l’unité des chrétiens qu’en 1964, lors du Concile Vatican II144.
Puisqu'elle reconnaît deux sources de dogme, la Bible et la tradition, l’Église catholique rejette évidemment le fondamentalisme, particulièrement le fondamentalisme biblique, comme l'indique la définition qu'elle donne elle-même du fondamentalisme : « Radicalisme religieux qui se réfère à une lecture littérale des textes sacrés sans tenir compte de la culture dans laquelle furent écrits les livres de l’Ancien et du Nouveau Testaments. Le fondamentalisme exclut toute approche critique, pourtant nécessaire, des textes fondateurs »145. De plus, le catholicisme américain a publié toute une littérature apologétique au milieu des années 1980 pour combattre le fondamentalisme protestant146. Même si le catholicisme, en lui-même peu homogène, bénéficie d'une certaine cohésion grâce notamment à sa Congrégation pour la doctrine de la foi, cela n’empêche pas le fondamentalisme d’influencer une partie de ses adeptes. En effet, le sociologue Émile Poulat observe que « le fondamentalisme trouve aujourd’hui, dans les milieux catholiques plus de connivences qu’on ne l’imagine »147. Selon le théologien et prêtre catholique Pierre Lathuilière, si l'on analyse le conservatisme catholique français après Vatican II sous la loupe du fondamentalisme, on peut constater qu'il se diversifie selon au moins trois courants : intégriste, piétiste et charismatique148.
Le courant intégriste, le plus connu, cherche à « faire l'expérience de la Tradition »148. En raison de son organisation ecclésiale hiérarchisée, le catholicisme devrait échapper au fondamentalisme mais paradoxalement, il y succombe lorsqu’il absolutise la papauté, les doctrines et les dogmes149 : La compréhension des textes du Magister, s'ils sont lus isolément, au premier degré, hors contexte et sans interprétation ou herméneutique, ni méthode critique, peut devenir analogue à la compréhension de la Bible dans le fondamentalisme protestant150. Par exemple, le fondamentalisme apparaît lorsque la doctrine de l'Église conduit à une morale hétéronome qui rabat l'exercice de la conscience plutôt que la dynamiser133,136. Par ailleurs, la réintégration de Mgr. Marcel Lefebvre au sein du catholicisme montre davantage un compromis avec un courant intégriste particulier, qui avait rompu avec la papauté. Pierre Lathuilière indique qu’on observe dans ce milieu une vigoureuse reprise des thèses créationnistes, enrichies par l'antiévolutionnisme américain. Selon lui, des traditionalistes catholiques ont vu dans le retour des partisans de Mgr. Lefebvre « une force d'appoint dans leur lutte contre le modernisme »148.
Une deuxième courant, piétiste, est sensible à l’expérience de la conversion. Pierre Lathuilière, note que devant la sécularisation, ce courant piétiste oscillera entre apologétique et fidéisme148. Le troisième courant, charismatique, est venu des États-Unis après le Concile. Il s’apparente au pentecôtisme mais n’est pas nécessairement fondamentaliste ni même conservateur. De ce point de vue, selon Pierre Lathuilière, il apparaît aussi riche en potentialités diverses que les autres formes d'évangélicalisme. Toutefois, il pourra devenir comparable aux « communautés émotionnelles » du fondamentalisme protestant, où « l'inspiration de l'Esprit » permettra à chacun d'interpréter la Bible à l'écart de tout « intellectualisme »146,151.
« « Epistemological Fundamentalism: a. Accommodating Science: Most contemporary naturalists take science to be an enormously successful enterprise, and so other knowledge claims must either cohere with the findings of our best science or explain those findings away. […] Because naturalists are typically committed to science as a central, infaillible, avenue of knowledge about the world (i.e. some variety of epistemic fundamentalism), naturalists will want to explain how this can be if, as social constructionists about scientific representations note, empirical observation is theory-laden and scientific theories are themselves subject to massive social influences. » »

09:21 Publié dans Apolégétique | Lien permanent | Commentaires (0)
|
Aux sources du protestantisme intégral |
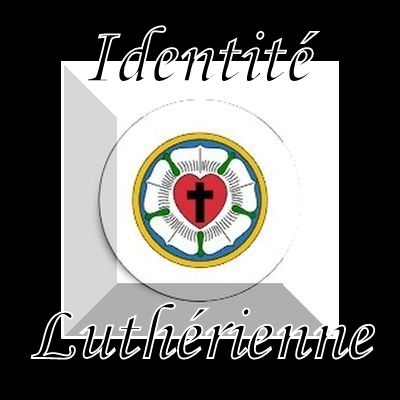
1) Constat sur la situation en France:
En dehors de fortes minorités (africaines et musulmanes), la majorité de notre pays est composé de français et européens de souche (dans le sud-est: les Italiens, le sud-ouest les Espagnols, le nord les Polonais, région parisienne les portugais). A l'exception de ces derniers, l'écrasante majorité a perdu tous liens avec ses racines chrétiennes, pour tomber dans le consumérisme paganisant.
La présence de plus de 10% de musulmans (7 millions), dont beaucoup se radicalisent, a un effet de radicalisation sur les populations européennes, par exemple: Vallsqui fait la politique de Sarkozy, Copé qui parle de racisme anti-blanc, discours qui est celui des droites les plus radicales.
2) Situation des Eglises en France:
L'Eglise Catholique qui, il y a cent ans, représentait l'immense majorité, est en complète déliquescence, gangrénée par le libéralisme et sa complaisance vis-à-vis de l'Islam. Le traditionalisme, même s’il représente une puissance, est lui-même ghettoïsé par sa théologie, en se coupant de la société réelle.
Le protestantisme libéral qui a pendant si longtemps dominé les autres Eglises, est en perte de vitesse, et, d'une année sur l'autre, perd des forces vives au profit des Evangéliques.
Ce sont eux qui représentent l'aile dynamique du Christianisme. Comme dans le reste du monde, leur croissance est exponentielle. Ils touchent toutes les catégories sociales, mais plus particulièrement la communauté Afro-Antillaise. La raison d'un tel succès vient de la simplicité de leur message qui peut s'adapter à toutes les situations, de leur enthousiasme, de leur prosélytisme, et enfin de leur structure peu contraignante qui leur permet de s'adapter à toutes les contingences.
Les Luthériens confessionnels, ultra-minoritaires, sommes coupés des autres Eglises par notre doctrine des moyens de grâce, qui nous empêche de nous unir pour l'Evangélisation à l’instar des Evangéliques. Tout cela nous a conduit à la marginalité, qui ne fait qu'accentuer notre théologie qui, par sa complexité, ne peut toucher tout le monde et en particulier ceux qui n'ont aucune culture religieuse. Encore une fois la force des Evangéliques est la simplicité pour se mettre a la portée de la population.
3) Rôle d' Identité Luthérienne:
Dans un pays dechristianisé, mais de plus en plus conservateur, l'écrasante majorité ne se retrouve pas dans le Catholicisme. L'évolution du protestantisme libéral vers une unification des Eglises répugne à beaucoup. Notre propos est de montrer que, à coté d'un Catholicisme intégriste, il y a un protestantisme intégral, qui contrairement à eux est ouvert sur le monde et son évolution.
A nous d'être attractif, et de montrer que le Luthéranisme tant sur le plan théologique que sociétal répond aux attentes théologiques et morales, comme l'indique le sous-titre de l'association "la source du protestantisme intégral".
Avec un matériel didactique adapté, nous nous rendrons à toutes les manifestations, tant chez les libéraux que chez les Evangéliques, pour susciter des débats et faireconnaitre nos positions. Nous nous rendrons aussi à toutes les manifestations non-religieuses conservatrices, où il sera bon de montrer qu'il y une voie pour ceux qui sont en recherche.
Tout cela ne donne aucune garantie que des personnes voudront devenir membre du synode, mais nous pouvons espérer que sur le débat de société, cela amène certains à s'interroger spirituellement et à venir nous rejoindre.
Mais un autre intérêt de notre association sera de nous insérer dans le débat sociétal, à l'époque d'internet nous faire connaitre est capital, peu savent que nous existons. La crise que traverse notre pays n'a qu'une réponse spirituelle, faire savoir à beaucoup qu'il y a un chemin, en nous sortant de la marginalité où nous sommes enclavés, est une mesure de salubrité publique.
4) L'avenir du Luthéranisme confessionnel en France:
Celui-ci a vu le jour en Alsace où le particularisme tranche avec toutes les autres régions (excepté la Corse), où pendant longtemps le vieux fond germanique amenait les enfants à suivre naturellement leurs parents au sein de l'Eglise.
Il va y avoir un siècle qu'elle a réintégré la mère patrie, un siècle d'école laïque obligatoire et de culture latine, qui a fini par faire des Alsaciens, comme des autres français, des individualistes qui suivent de moins en moins les préceptes des pères.
Si le synode ne s'adapte pas à cette nouvelle donne, il prend le risque avec le temps de voir son vivier naturel s'épuiser, si il continue de rester marginal, il aura du mal à s'ouvrir à d'autres composantes de la société, c’est le propos " d'Identité Luthérienne" : ouvrir les portes et les fenêtres au monde d'aujourd'hui.
Jean-Pierre BLANCHARD, Pasteur
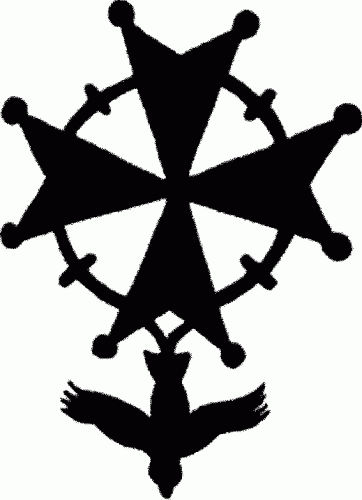
09:34 Publié dans Apolégétique | Lien permanent | Commentaires (0)