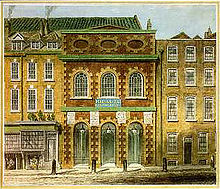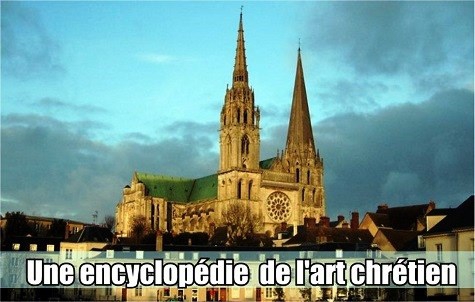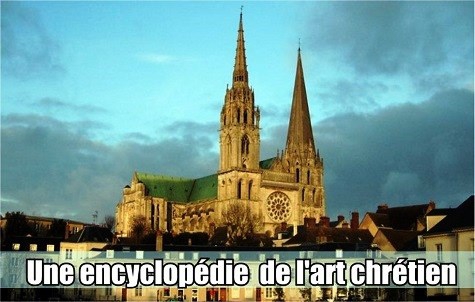Haendel par Balthasar Denner (1727)
Georg Friedrich Haendel ou Händel (George Frideric Handel en anglais, comme il l'écrivait lui-même est un compositeur allemand, naturalisé britannique, né le 23 février 1685 à Halle et mort le 14 avril 1759 à Londres.
Haendel personnifie souvent de nos jours l'apogée de la musique baroque aux côtés de Bach. Né et formé en Saxe, installé quelques mois à Hambourg avant un séjour initiatique et itinérant de trois ans en Italie, revenu brièvement à Hanovre avant de s'établir définitivement en Angleterre, il réalisa dans son œuvre une synthèse magistrale des traditions musicales de l'Allemagne, de l'Italie, de la France et de l'Angleterre.
Virtuose hors pair à l'orgue et au clavecin, Haendel dut à quelques œuvres très connues notamment l'oratorio Le Messie, ses concertos pour orgue et concertos grossos, ses suites pour le clavecin, ses musiques de plein air (Water Music et Music for the Royal Fireworks) de conserver une notoriété active pendant tout le XIXe siècle, période d'oubli pour la plupart de ses contemporains. Cependant, pendant plus de trente-cinq ans, il se consacra pour l'essentiel à l'opéra en italien (plus de 40 partitions d'opera seria ), avant d'inventer et promouvoir l'oratorio en anglais dont il est un des maîtres incontestés
.
Son nom peut se trouver sous plusieurs graphies : en allemand, Händel peut aussi s'écrire Haendel (le « e » remplaçant l'umlaut, orthographe souvent préférée en français) et, après son installation en Angleterre, lui-même l'écrivait sans tréma : Handel, qui est la manière retenue par les anglophones.
Biographie
Les origines

Maison natale de Haendel à
Halle.
Au XVIIe siècle on est le plus souvent musicien de père en fils. Rien de tel pour Haendel, seul musicien d'une famille originaire de Silésie et de confession luthérienne : son grand-père, Valentin, est né à Breslau en 1583 ; venu s'installer à Halle en 1609, il y exerce la profession de chaudronnier. Le nom de la famille est alors orthographié de multiples façons, dont cinq attestées dans les registres de la Liebfrauenkirche (Église Notre-Dame) de Halle, soit : Händel, Hendel, Handeler, Hendeler, Hendtler - la première étant la plus courante, et interchangeable en allemand avec « Haendel ».
Valentin Haendel étant mort en 1636, ses deux premiers fils reprennent son affaire ; le troisième, Georg (1622-1697), père du futur musicien, n'a alors que quatorze ans : il entre comme apprenti chez un chirurgien-barbier qui va décéder six ans plus tard, sans enfants. Sa veuve, âgée de 31 ans, épouse l'apprenti qui n'en a que 21, et lui donne six enfants. Leur mariage doit durer 40 ans, au cours desquels la compétence de Georg Haendel est largement reconnue au point qu'il réussit à entrer au service de la famille d'Auguste de Saxe-Weissenfels, administrateur de Halle en usufruit jusqu'à sa mort en 1680. À cette date, la cité revient sous l'autorité effective du duc de Brandebourg-Prusse, comme prévu lors de la signature des traités de Westphalie en 1648. Georg Haendel est une personnalité importante de la cité, bourgeois aisé et de caractère austère ; il prend soin de se recommander au nouveau maître de la ville et parvient à se faire nommer Médecin Officiel des Électeurs de Brandebourg
.
Devenu veuf en 1682, il se remarie l'année suivante (23 avril 1683) avec Dorothea Taust (1651-1730), fille d'un pasteur, plus jeune que lui de près de trente ans
.
1685-1702 : Enfance et adolescence à Halle
Après un premier fils mort quelques jours après sa naissance, Georg Friedrich est leur second enfant, né le 23 février 1685. Il faut donc remarquer que celui qu'on va pendant toute sa vie désigner comme « Saxon » voit le jour en tant que sujet du duc de Brandebourg, futur roi de Prusse. Il est baptisé dans la confession luthérienne dès le lendemain à la Liebfrauenkirche.
Plus tard le suivent deux sœurs, Dorothea Sophia née en 1687 et Johanna Christiana, née en 1690
.
Les faits et anecdotes concernant l'enfance de Haendel ont presque tous pour source la première biographie du musicien rédigée vers 1760 par John Mainwaring : ils sont toutefois à considérer avec précaution car entachés d'incohérences quant à leur chronologie
.
Haendel montre très tôt de remarquables dispositions pour la musique. Sa mère y est sensible, mais son père s'y oppose avec fermeté. Il veut faire de son fils un juriste, meilleur moyen selon lui de poursuivre l'ascension sociale qui a été la sienne. Considérant la musique comme une activité de peu de valeur, il tente d'en détourner son fils en lui interdisant de toucher un instrument. Le garçon, entêté, parviendrait cependant à dissimuler un clavicorde au grenier et à continuer à en jouer lorsque la famille repose
.
L'opposition du père diminue à la suite d'une visite rendue à son ancien maître, le duc Jean-Adolphe Ier de Saxe-Weissenfels, à laquelle s'est joint le jeune Georg Friedrich. Ayant entendu ce dernier jouer de l'orgue à la Chapelle Ducale, le duc conseille au père de ne pas s'opposer à l'inclination et au talent de son fils, mais de le confier à un bon professeur de musique. De retour à Halle, celui-ci peut donc bénéficier de l'enseignement de l'organiste de la Liebfrauenkirche, Friedrich Wilhelm Zachow, sans que soit abandonnée pour autant l'idée d'une carrière juridique
.
Zachow est un esprit curieux, musicien de talent et ouvert aux diverses influences du temps. Il lui donne une éducation musicale complète ; il lui apprend à jouer de plusieurs instruments : clavecin, orgue, violon, hautbois... et lui enseigne les bases théoriques de la composition musicale : harmonie, contrepoint, fugue, variation, formes musicales. L'apprentissage se fonde aussi sur l'étude des œuvres des maîtres que l'élève recopie sur un cahier ; il se familiarise ainsi avec les principaux compositeurs de son temps, outre Zachow lui-même, Froberger, Kerll, Krieger et d'autres. Le jeune garçon se met très tôt à composer des œuvres instrumentales et vocales : la plupart de celles remontant aux années 1696 ou 1697 sont perdues, mais certaines sont conservées, tels les Drei Deutsche Arien, quelques cantates ou sonates
.

Le jeune Haendel au clavier

La cathédrale de Halle dont Haendel tint l'orgue en 1702/1703
Âgé d'environ douze ans, il fait un séjour à Berlin qui le met en contact avec la cour de l'Électeur Frédéric III de Brandebourg, le futur roi en Prusse Frédéric Ier. La date exacte ainsi que les circonstances en restent très imprécises. Selon certains, ce serait vers 1696. Pour d'autres, s'appuyant sur Mainwaring dont le témoignage est sujet à caution, ce pourrait être en 1697 ou 1698, année indiquée par Johann Mattheson. Les avis divergent aussi quant à savoir s'il est accompagné de son père (mort le 11 février 1697) ou si celui-ci est resté à Halle, attendant son retour, ce qui ne permet pas de lever l'incertitude. Des circonstances rapportées aussi par Mainwaring achèvent d'embrouiller les hypothèses, car elles aboutissent à des incohérences par rapport à d'autres sources connues et plus fiables : Haendel y aurait rencontré Giovanni Bononcini et Attilio Ariosti dont les séjours attestés par ailleurs à Berlin sont plus tardifs. En fait, il semble que Haendel ait entreprit en 1702, à l'âge de 17 ans, un deuxième voyage à Berlin, ville depuis laquelle était gouvernée Halle. C'est lors de ce deuxième voyage qu'il aurait rencontré Ariosti et Bononcini et joué devant le roi de Prusse
.
Toujours est-il qu'il fait grande impression à la Cour que l'Électrice Sophie-Charlotte anime d'une vie musicale intense. Frédéric III lui proposerait de le prendre à son service après l'avoir envoyé se perfectionner en Italie, offre qui est déclinée ; mais on ne sait pas si c'est à la prière du père, près de mourir et réclamant le retour de son fils, ou du fait de celui-ci. Les tenants de la première hypothèse, à la suite de Romain Rolland affirment même que le garçon revient dans sa ville natale le 15 février 1697 pour y trouver son père décédé depuis quatre jours.
Cinq ans après la mort de son père, respectant sa volonté, il s'inscrit le 10 février 1702 à l'université de Halle afin d'y suivre des études juridiques. Il ne se fait cependant immatriculer dans aucune faculté, et ne restera étudiant que peu de temps. Le 13 mars suivant, il est nommé organiste de la cathédrale calviniste de Halle (bien qu'il soit lui-même luthérien) en remplacement du titulaire, pour une période probatoire d'une année. Il s'assure ainsi l'indépendance financière, dans une fonction qu'il ne va cependant pas occuper au delà de la période d'essai C'est pendant cette période qu'il se lie durablement avec Georg Philipp Telemann qui se rend à Leipzig et fait étape à Halle
.
1703-1706 : Début de carrière à Hambourg

L'opéra
am Gänsemarkt à Hambourg
Il demeure donc peu de temps à ce poste, ne renouvelant ni son contrat ni son inscription à l'université : au printemps ou à l'été 1703, il quitte Halle de façon définitive pour aller s'installer à Hambourg.
La grande et très prospère cité hanséatique est alors le principal centre culturel et musical de l'Allemagne du Nord ; l'activité artistique y est intense et attire depuis longtemps nombre de musiciens, instrumentistes et compositeurs ; c'est ici qu'a été fondé dès 1678 le premier théâtre d'opéra allemand, l'Oper am Gänsemarkt. L'opéra allemand, alors à ses débuts, est sous l'influence dominante de l'opéra italien, particulièrement vénitien, les textes des livrets combinant de façon improbable textes italiens et allemands sur une musique de caractère cosmopolite
.

Mattheson est la « bonne étoile » de Haendel à Hambourg
À l'époque ou Haendel arrive, l'opéra est dominé par Reinhard Keiser, à la direction du Gänsemarktoper depuis 1697. Haendel peut y trouver un poste de second violon puis de claveciniste, peut-être par l'entremise de Johann Mattheson, rencontré dès le 9 juillet à l'orgue de l'église Sainte Marie-Madeleine. Ce dernier a quatre ans de plus, et il est déjà un musicien célèbre, ayant été engagé à l'opéra de Hambourg comme chanteur à l'âge de quinze ans. Ils se lient d'amitié et Mattheson, introduit dans tous les milieux qui comptent à Hambourg - il devient même en novembre, précepteur chez l'ambassadeur d'Angleterre - y fait connaître son nouvel ami. C'est en tout cas ce qu'il affirmera plus tard dans ses écrits
.
Les deux musiciens se portent une mutuelle admiration, et échangent connaissances, idées, conseils : Haendel est très fort à l'orgue, en fugue et contrepoint, en improvisation ; quant à Mattheson, il a plus d'expérience de la séduction mélodique et des effets dramatiques. Le 17 août, ils partent ensemble pour Lübeck afin d'y entendre et rencontrer Dietrich Buxtehude, le plus fameux organiste du temps, peut-être dans l'espoir d'y recueillir sa succession à la prestigieuse tribune de la Marienkirche ; mais la condition - qui a été satisfaite en son temps par Buxtehude lui-même - est d'épouser la fille de l'organiste titulaire, ce qui ne tente aucun des deux jeunes gens (semblable aventure se reproduira dans deux ans pour Johann Sebastian Bach venu ici dans la même intention)
.
Les deux amis retournent à Hambourg où Haendel se familiarise jour après jour avec le monde de l'opéra. Grâce à Mattheson, il trouve à donner des leçons de clavecin. Nombre de pièces pour cet instrument remonteraient à cette période hambourgeoise, comme de très nombreuses sonates et les concertos pour hautboi. On lui a attribuera longtemps une Johannis Passion (Passion selon Saint Jean) représentée le 17 février 1704, qui aurait été sa première œuvre importante. En fait, selon Winton Dean, elle serait due à Mattheson ou à Georg Böhm.
En décembre 1704, un incident l'oppose à Mattheson, qui aurait pu lui coûter la vie : lors d'une représentation de l'opéra Cleopatra de Mattheson dans lequel ce dernier tient lui-même le rôle d'Antoine, Haendel refuse de lui céder la place au clavecin après la mort, sur scène, du héros : l'affaire se termine par un duel au cours duquel l'épée de Mattheson le manque de très peu. Les deux hommes se réconcilient peu de temps après. De fait, les relations ne sont plus aussi bonnes qu'auparavant, car Haendel supporte de moins en moins l'air important, le ton protecteur de son ami. De même avec Keiser, les relations sont devenues tendue.
Il aborde l'opéra pour la première fois avec Almira (titre complet : Der in Krohnen erlangte Glücks-Wechsel oder Almira, Königin von Castilien) sur un livret de Friedrich Christian Feustking, dont la première a lieu le 8 janvier 1705. C'est une œuvre hybride à l'exemple de ce qui se fait à Hambourg : ouverture à la française, récitatifs en allemand, arias en allemand ou en italien, machinerie, danses, présence d'un personnage bouffon; la musique de Haendel, qui a peut-être été aidé par Mattheson et bien qu'elle « manque encore de maturité » lui assure un succès considérable (plus de vingt représentation) et la jalousie de Keiser. Le succès ne se renouvelle pas pour le deuxième opéra, Nero, présenté le 25 février 1705 et honoré de deux ou trois représentations seulement (la musique en est perdue). Keiser réplique à Haendel par la composition de deux opéras sur les mêmes intrigues : Almira et Octavia: les relations conflictuelles avec Keiser, la situation difficile de l'opéra due à sa direction désordonnée et l'échec de Nero jouent probablement un rôle important dans la décision que prend Haendel de partir pour l'Italie, sur les conseils de Gian Gastone de' Medici, futur grand-duc de Toscane rencontré à Hambourg(à moins qu'il ne s'agisse de son frère aîné Ferdinando). Il a auparavant composé un dernier opéra, Florindo, dont la musique est presque entièrement perdue, et qui est représenté en 1708 après son départ, d'ailleurs scindé en deux (Florindo et Daphne) pour cause de longueur excessive
1706-1710 : l'Italie
Les conditions et le trajet du voyage qui le mène en Italie ne sont pas connues (Mattheson indique qu'il aurait accompagné un certain von Binitz). Quant au séjour italien lui-même, qui doit durer trois ans et qui est décisif dans l'évolution de son style et de sa carrière, les informations dont on dispose sont imprécises et lacunaires ; elles prêtent à de nombreuses interprétations ou suppositions contradictoires.

Le Grand-Duc de Toscane Ferdinand III
Tableau de Niccolò Cassani
Galerie des Offices, Florence
Il est probable - c'est ce qu'affirme Mainwaring - que sa première étape soit Florence ou il arrive à l'automne 1706. Une certaine déception est peut-être au rendez-vous, car le prince régnant, Cosme III, est de caractère austère et ne s'intéresse ni à l'art en général, ni à la musique en particulier ; quant au soutien obtenu du prince héritier Ferdinand, il reste mesuré. Haendel y fait cependant des rencontres intéressantes, comme celle d'Alessandro Scarlatti, alors présent au service de Ferdinand, et, peut-être, de Giacomo Antonio Perti : il entend probablement des opéras de ces deux compositeurs représentés au théâtre privé de Pratolino, comme Il gran Tamerlano de Scarlatti, ou Dionisio re di Portogallo de Perti. A Florence il fait aussi très certainement connaissance d'Antonio Salvi, médecin et poète à la cour grand-ducale, dont il utilisera plus tard plusieurs livrets d'opéras. Datant de 1707, Rodrigo est le premier opéra de Haendel écrit pour la scène italienne, représenté probablement en novembre 1707 au théâtre Cocomero à la suite d'une commande de Ferdinand de Médicis, qui récompense Haendel en lui donnant 100 sequins et un service de porcelaine. Ce dernier y aurait aussi gagné les faveurs de la prima donna Vittoria Tarquini - l'une des seules liaisons féminines de Haendel rapportées par la traditio. Il fait semble-t-il chaque année qui suit d'autres séjours assez prolongés à Florence
.

L'orgue de Saint-Jean-de-Latran
C'est à Rome que, probablement il passe la plus grande partie de son séjour en Italie, entrecoupé de voyages attestés ou probables à Naples, Venise, Florence ... Il y arrive en janvier 1707 comme en témoigne le journal d'un bourgeois de cette ville, en date du 14 janvier : « Un allemand vient d'arriver dans la ville, qui est un excellent joueur de clavecin et un compositeur. Aujourd'hui, il a fait montre de son talent en jouant de l'orgue à Saint-Jean-de-Latran à l'admiration de chacun. »
.
Bien que luthérien, Haendel ne tarde pas à avoir ses entrées auprès de personnalités influentes de la cité papale, notamment le marquis Francesco Ruspoli (it) et au moins trois cardinaux de l'Église Catholique : Benedetto Pamphili, Carlo Colonna et Pietro Ottoboni, fastueux mécène . Au palais de ce dernier, comme dans le milieu prestigieux des lettrés de l'Académie d'Arcadie dont font partie certains de ses protecteurs, il fréquente de nombreux artistes et musiciens, parmi lesquels Arcangelo Corelli, Antonio Caldara, Alessandro Scarlatti et son fils Domenico, Bernardo Pasquini, probablement Agostino Steffani ; son talent est apprécié et lui ouvre toutes les portes. C'est au palais d'Ottoboni, à une date indéterminée, qu'il participe à une joute musicale l'opposant à Domenico Scarlatti, claveciniste éblouissant qui a le même âge que lui. Si les deux musiciens sont jugés, peut-être, égaux au clavecin, Scarlatti lui-même reconnaît la supériorité de Haendel à l'orgue. Mais les deux jeunes gens resteront liés par une amitié et une considération mutuelle indéfectibles. Dès avant mai 1707, il compose son premier oratorio, sur un livret du cardinal Pamphili : Il trionfo des Tempo e del Disinganno. Il est accueilli et engagé, de façon intermittente et assez informelle, par le marquis Ruspoli, qui le loge, pour composer des cantates séculières interprétées dans ses résidences de campagne de Cerveteri et de Vignanello. Il y fait la connaissance de chanteurs et musiciens qu'il retrouvera plus tard à Londres, notamment la soprano Margherita Durastanti
.
Le séjour romain est extrêmement fécond. Haendel compose de la musique religieuse : les psaumes Dixit Dominus (avril 1707), son premier grand chef d'œuvre, Laudate Pueri Dominum, et Nisi Dominus (juillet 1707). On lui suggère d'ailleurs de passer au catholicisme, invitation qu'il décline avec politesse et fermeté. Pour Ruspoli, il compose un grand oratorio dramatique, également considéré comme un de ses premiers chefs d'œuvre, La Resurrezione, sur un livret de Carlo Sigismondo Capece. L'œuvre représentée les 8 et 9 avril 1708 dans un théâtre spécialement aménagé dans le palais du commanditaire est interprétée sous la direction de Corelli avec la participation de la Durastanti ; le succès est exceptionnel. Pour ses protecteurs ou les séances de l'Académie d'Arcadie, il compose un nombre considérable de cantates profanes (150 au dire de Mainwaring, et il en subsiste près de 120) ainsi que des sonates et autres musiques. Pas d'opéra, cependant : ce genre est en effet prohibé à Rome depuis des années par décision du pape Innocent XII
.
Les bruits de guerre qui se rapprochent de Romesont peut-être la cause d'un séjour prolongéà Naples à partir de mai ou juin 1708. L'aristocratie locale le reçoit avec empressement et lui prodigue une fastueuse hospitalité. Il compose notamment, pour un mariage ducal, la serenata à caractère festif Aci, Galatea e Polifemo ; il est aussi introduit auprès du vice-roi de Naples, le cardinal Vincenzo Grimani, prélat, lettré et diplomate issu d'une grande famille vénitienne propriétaire dans la Cité des Doges du théâtre San Giovanni Grisostomo : ce dernier va composer pour lui le livret d'un opéra qu'il pourra donc représenter à Venise. A Naples se noue aussi, peut-être, une idylle avec une énigmatique « Donna Laura ».
Peut-être est-il venu plusieurs fois à Venise : ce serait ici qu'il aurait fait la connaissance de Domenico Scarlatti ainsi que de plusieurs musiciens de renom animant la vie musicale exceptionnelle de la cité, notamment Antonio Lotti, Francesco Gasparini, Tomaso Albinoni, peut-être Antonio Vivaldi et de plusieurs personnages influents tels le prince Ernest-Auguste de Hanovre et le baron von Kielmansegg qui joueront un rôle important dans sa carrière
.
En tous les cas, c'est le 26 décembre 1709 qu'il assiste à la première de son opéra Agrippina sur le livret que lui a écrit le cardinal Grimani et dans le Teatro San Giovanni Grisostomo que celui-ci met à disposition. L'œuvre, représentée dans une distribution éclatante, recueille un succès immédiat et phénoménal au cours de 27 soirées - chiffre considérable à cette époque Le public enthousiaste fait un triomphe au caro Sassone (« Cher Saxon ») qui s'apprête maintenant à quitter l'Italie.
En effet, la renommée qu'il a acquise dans la péninsule, et particulièrement à Venise que visitent tant de princes ou souverains étrangers attirés par son exceptionnelle animation culturelle, lui a certainement apporté des propositions intéressantes d'engagement à des postes prestigieux et notamment de l'Électeur de Hanovre, sur la recommandation d'Agostino Steffani sans doute appuyée par le prince Ernst-August et le baron von Kielmansegg qui ont assisté au triomphe d' Agrippina ; peut-être encore de l'Électeur Palatin et de son épouse (une sœur de Ferdinand de Medicis), tous deux grands amateurs de musique. Probablement aussi le comte de Manchester, ambassadeur de Grande-Bretagne, lui a-t-il évoqué toutes les opportunités qui pourraient s'offrir à Londres, ville alors la plus peuplée d'Europe. Il quitte l'Italie en février 1710, passe par Innsbruck ou il décline une offre du gouverneur du Tyrol et revient en Allemagne
.
Le séjour en Italie est donc déterminant à de nombreux titres : il a pu s'imprégner, à la source, de la musique italienne, de son environnement et de sa pratique, côtoyer et se mesurer aux musiciens les plus célèbres, lier connaissance avec nombre de chanteurs et chanteuses qu'il retrouvera plus tard, se constituer un vaste répertoire (vocal particulièrement) dans lequel il ne manquera pas de puiser par la suite et se faire une renommée auprès de grands personnages, mécènes potentiels influents
.
1710-1712 : Maître de Chapelle à Hanovre

Portrait de Steffani (lithographie de 1816) d'après un original perdu
Arrivé à Hanovre, il est nommé le 16 juin, maître de chapelle de l'Électeur, poste jusque là occupé par Agostino Steffani, sur la chaude recommandation de ce dernier. Son salaire est important (1000 thalers) et il obtient l'avantage de pouvoir prendre aussitôt un congé d'un an pour se rendre à Londres. Son trajet le fait passer à Halle où il revoit sa mère et son maître Zachow puis à Düsseldorf ou il est reçu avec faveur par l'Électeur Palatin et son épouse ; il quitte Düsseldorf en septembre pour Londres via les Pays-Bas
.
À Londres, il ne tarde pas à être présenté à la reine Anne, à y rencontrer de nombreux artistes chez le marchand de charbon mélomane Thomas Britton, et à faire la connaissance de deux personnages importants dans le monde de l'opéra : l'auteur dramatique et directeur de théâtre Aaron Hill et son assistant, suisse immigré, Johann Jacob Heidegger. Depuis la mort de Purcell en 1695, il n'y a plus de compositeur de premier plan en Angleterre et l'opéra anglais disparaît, laissant la place vers 1705 à l'opéra italien de facture ou d'interprétation souvent médiocre.
Aaron Hill a l'idée de monter un opéra avec l'aide de Haendel. Il en écrit le livret, le fait traduire en italien par Giacomo Rossi et Haendel compose la musique, selon Mainwaring, en deux semaines : ce sera Rinaldo, tout premier opéra italien spécifiquement créé pour la scène anglaise, dont la première a lieu le 24 février 1711 dans une mise en scène luxueuse et avec une distribution de choix. Le succès est impressionnant pendant 15 représentations jusqu'en juin. L'année de congé étant écoulée, Haendel quitte Londres vers le début de juin, y laissant sa réputation assurée, et retourne à Hanovre en passant par Düsseldorf
.
Revenu à Hanovre, il reste en contact avec les nombreuses relations qu'il s'est faites à Londres, et perfectionne son anglais. Il fait en novembre un voyage à Halle, pour le baptême de sa nièce et future héritière, Johanna Friderica, en tant que parrain. Il n'y a pas d'opéra à Hanovre, mais un bon orchestre ; il compose des duos, de la musique instrumentale, et s'ennuie probablement : il ne pense qu'à l'Angleterre, aux succès remportés auprès du public, de l'aristocratie et de la Cour ; à l'automne 1712, il obtient à nouveau la permission d'un second voyage à Londres, à la condition de s'engager à revenir dans un délai raisonnable. En fait, ce nouveau départ se révélera définitif.
1712-1719 : Premières années en Grande-Bretagne
De retour en Angleterre, il vit pendant un an chez un certain Mr Andrews, mélomane fortuné, à Barn Elms (Barnes) dans le Surrey, avant d'être hébergé, de 1713 à 1716 chez le comte de Burlington à Picadilly. Richard Burlington est un riche mécène chez lequel il rencontre de nombreux lettrés et artistes parmi lesquels Pope , Gay, Arbuthnot. Il fait aussi à cette époque la connaissance d'un amie et admiratrice indéfectible, Mary Granville, plus tard Mrs Delany puis Mrs Pendarves, qui par sa correspondance est un témoin appréciable de l'activité musicale de Haendel. Chez Burlington, sa vie est tranquille et régulière : il compose le matin, déjeune avec l'entourage de son hôte et l'après midi, joue pour la compagnie ou fréquente des concerts.
Dès le 22 novembre 1712, son opéra Il pastor fido est représenté au Queen's Theatre ; mais l'œuvre, qui semble avoir été composée à la « va-vite » avec de nombreux réemplois d'œuvres antérieures, est un échec. C'est ensuite Teseo, représenté le 10 janvier 1713, qui a plus de succès, avec 12 reprises dans la saison, mais sans égaler celui de Rinaldo ; son livret est une adaptation par Nicola Francesco Haym de celui de Philippe Quinault pour le Thésée de Lully créé en 1675 : Teseo restera le seul opéra de Haendel comportant cinq actes selon la tradition de la tragédie en musique française. Il sera suivi de Silla, représenté (en privé) une seule fois, le 2 juin 1713, probablement à Burlington House.
Pour le 6 février 1713, Haendel prévoit de donner à la Cour l' Ode for the Birthday of Queen Anne pour l'anniversaire de la reine, représentation qui n'a finalement pas lieu. En revanche le 7 juillet suivant, l' Utrecht Te Deum and Jubilate saluant la Paix d'Utrecht est interprété à la cathédrale Saint Paul : Haendel s'assure une position officieuse de compositeur de la Cour et reçoit une pension annuelle de 200 £, rendant sa position délicate vis-à-vis de l'Électeur de Hanovre au service duquel il semble de moins en moins envisager de revenir[
.

Le nouveau roi, George I
er
Cette « désertion » aurait pu lui porter préjudice : la reine Anne décède le Ier août 1714 et son successeur désigné n'est autre que son cousin l'Électeur de Hanovre, arrière-petit-fils de Jacques Ier. Différentes versions existent, du retour en grâce de Haendel auprès du nouveau roi d'Angleterre arrivé à Saint James le 20 septembre. L'une d'elle (rapportée par Mainwaring) veut que Haendel compose une suite pour orchestre, sur la suggestion du baron Kielmansegg, afin d'accompagner une promenade de George Ier sur la Tamise. Une autre (selon Hawkins), que Geminiani exige d'être accompagné au clavecin par Haendel pour l'interprétation, à la Cour, de plusieurs de ses sonates. Enfin Winton Dean estime qu'il est « peu probable que le roi lui ait jamais retiré ses faveurs ». De fait, George Ier double la pension que lui a attribué la reine Anne et celle-ci sera encore augmentée quand Haendel prendra en charge l'instruction musicale des princesses royales, filles du Prince de Galles
.
Renouant avec la tradition française de Teseo et avec la veine « magique » qui a si bien réussi à Rinaldo, il compose en 1715 Amadigi sur un livret, adapté par Nicola Francesco Haym, de Antoine Houdar de la Motte : Amadis de Grèce et en réutilisant un matériel musical important repris de Silla. Malgré un succès honorable, et pour diverses raisons, Haendel délaissera l'opéra pendant près de cinq ans
.
En 1716, il accompagne le souverain qui se rend à Hanovre. Il s'arrête à Halle, y visite sa mère et porte assistance à la veuve de Zachow (son ancien maître), puis à Ansbach où il retrouve un ancien condisciple, Johann Christoph Schmidt, qu'il convainc de le suivre et qui deviendra son secrétaire en Angleterre sous le nom anglicisé de John Christopher Smith. Le fils de ce dernier, portant le même prénom les rejoint également quelque temps après. Il n'est pas oublié dans son pays natal où ses opéras sont et continueront d'être montés, éventuellement adaptés, à Hambourg, Wolfenbüttel, Brunswick ...
Il compose peut-être pendant ce séjour en Allemagne la « Passion selon Brockes » sur un texte en allemand, déjà mise en musique par Keiser (1712) et Telemann (1716) et qui le sera aussi par Mattheson en 1718 et Bach en 1723 (!). L'œuvre ne sera donnée à Hambourg qu'en 1719 après son retour en Angleterre.
C'est après ce retour, le 17 juillet 1717, qu'a lieu la célèbre et presque légendaire navigation nocturne sur la Tamise, entre Whitehall et Chelsea, du roi accompagné de ses courtisans, au son de la Water Music composée à cet effet. Le roi apprécie l'œuvre au point qu'elle est interprétée trois fois de suite ; elle reste aujourd'hui l'une de ses œuvres les plus connues et les plus populaires.

James Brydges, Comte de Carnavon
Au cours de l'été, il s'attache au Comte de Carnavon, futur Duc de Chandos, richissime aristocrate et mécène fastueux, en tant que compositeur résident composant pour ses chanteurs et son orchestre privé, logeant probablement dans sa somptueuse résidence de Cannons. Il y compose les Chandos Anthems, le masque Acis and Galatea, une première version de l'oratorio Esther, un Te Deum, des concertos grossos ... Il apprend pendant cette période heureuse la mort à Halle de sa sœur Dorothea Sophia (juillet 1718) et se serait rendu en Allemagne si un projet majeur ne le retenait à Londres : la création d'une Royal Academy of Music, entreprise dédiée au montage d'opéras au King's Theatre, financée par souscriptions, à laquelle il doit collaborer
.
1720-1729 : La Royal Academy of Music
La Royal Academy, créée à l'initiative d'aristocrates proches du pouvoir royal, est dirigée par Heidegger, Paolo Rolli en est le librettiste officiel et Haendel, le directeur musical : il est chargé de se rendre sur le continent pour y engager les meilleurs chanteurs et en particulier, à tout prix, le castrat Senesino. Il se rend tout d'abord en Allemagne, passe par Dusseldorf et y rend visite à l'Électeur, puis à Halle. Averti de sa présence, Johann Sebastian Bach vient de Köthen à Halle pour y faire sa connaissance mais le manque de peu : Haendel est reparti pour Dresde ou il passe plusieurs mois ; il y retrouve Antonio Lotti et prend contact avec plusieurs de ses chanteurs (notamment Senesino et Margherita Durastanti) qui viendront plus tard à Londres
.
L'Académie ouvre le 2 avril 1720 avec la représentation du Numitore de Giovanni Porta avant Radamisto, composé par Haendel sur un livret adapté avec l'aide de Nicola Haym de L'amor tirannico de Domenico Lalli. Haendel le dédie au roi George Ier, et la première a lieu le 27 avril avec grand succès, malgré une distribution « de fortune » : tous les chanteurs ne sont pas encore arrivés, ni Giovanni Bononcini qui doit participer à l'entreprise et sera un rude concurrent
.
Pour l'heure, Haendel obtient un privilège royal pour l'édition de ses œuvres, afin de protéger ses droits, celles-ci circulant largement en copies et donnant même lieu à des publications « pirates », notamment à Amsterdam par les successeurs d'Estienne Roger. La publication de ses compositions lui apporte d'ailleurs des revenus opportuns, alors que ses économies ont fondu lors du krach consécutif à la spéculation sur la Compagnie des mers du Sud. C'est ainsi qu'il confie en novembre 1720 à John Christopher Smith la publication de Huit suites pour le clavecin, premier recueil publié sous son autorité et soigneusement gravé par John Cluer. Et il précise dans la préface : « I have been obliged to publish Some of the following Le∫sons, because Surrepticious and incorrect Copies of them had got Abroad. I have added several new ones to make the Work more u∫efull, which if it meets with a favourable Reception; I will Still proceed to publish more, reckoning it my duty, with my Small Talent, to ∫erve a Nation from which I have receiv'd so Generous a Protection. » . Le projet d'autres recueils de pièces pour le clavecin supervisés par Haendel lui-même n'aura, cependant, pas de suite
.
La seconde saison de l' Academy s'ouvre le 19 novembre 1720 avec Astarto de Bononcini qui remporte un succès encore plus extraordinaire que Haendel, continue avec une seconde version, profondément remaniée, de Radamisto dans laquelle Senesino fait ses débuts londoniens ; elle présente également un pasticcio (Muzio Scevola) dont la musique est confiée à trois compositeurs différents : Filippo Amadei pour l'acte I, Bononcini pour l'acte II et Haendel pour l'acte III : par son ovation, le public reconnaît ce dernier vainqueur de cette sorte de « Jugement de Pâris » Mais Bononcini se pose maintenant en rival redoutable, avec son style plus légerlui assurant nettement plus de représentations que Haendel.

Giovanni Battista Bononcini
Une prééminence certaine de Bononcini continue de prévaloir pendant la troisième saison (1721-1722), avec la présentation de Crispo et de Griselda pendant un total de 34 soirées, quand Haendel n'en assure que 15 avec Floridante. À partir de cette saison, son style va évoluer, pour mieux affronter les mélodies plus simples et de mémorisation plus facile de son compétiteur[D2. La rivalité des deux compositeurs trouve son parallèle dans celle des factions qui les supportent, que le caractère entier et arrogant de Haendel comme les intrigues de Rolli et de Senesino ne contribuent pas à apaiser
.
Haendel prend le pas sur Bononcini pendant la saison suivante, particulièrement marquée par le succès d'Ottone. Avec cet opéra, qui connaîtra le plus grand nombre total de représentations pendant toute la durée de la Royal Academy et dans une moindre mesure avec Flavio, Haendel dépasse pour la première fois Bononcini en nombre de soirées, même si l'arrivée d'Attilio Ariosti change la donne : Coriolano, son premier opéra pour la scène londonienne, y rencontre un succès presque aussi grand que celui d'Ottone. En fin d'année 1722 se situe l'arrivée à Londres de la célèbre Francesca Cuzzoni, et au début de 1723 une célèbre altercation avec Haendel : comme elle refuse d'interpréter l'aria Falsa imagine de son rôle dans Ottone, le compositeur manque de peu de la défenestrer ; cet air assurera pourtant la célébrité de la Cuzzoni à Londres sinon sa sympathie pour Haendel.

Maison de Haendel à Londres, 25 Brook Street
Pendant les deux saisons suivantes, Haendel éclipse ses compétiteurs. C'est à cette époque (à l'été 1723) qu'il acquiert une maison sur Brook Street, demeure qui restera la sienne jusqu'à sa mort. C'est aussi pendant cette période qu'il devient compositeur de la Chapelle Royale ; d'ailleurs, dès avant août 1724, il enseigne la musique aux princesses royales.
», il compose coup sur coup trois de ses plus grands chefs-d'œuvre : Giulio Cesare in Egitto (créé le 20 février 1724), Tamerlano (31 octobre 1724) et Rodelinda (13 février 1725), tous sur des livrets adaptés par Haym (ces adaptations consistent le plus souvent à raccourcir les récitatifs, qui lassent les amateurs ne comprenant pas l'Italien, à supprimer ou rajouter des airs selon l'inspiration du musicien, la distribution des chanteurs engagés et leurs desiderata). Selon Winton Dean, ces trois opéras « surpassent de beaucoup l'œuvre de tous ses contemporains »
.
Cette année 1725, les directeurs invitent la célèbre Faustina Bordoni, qui n'arrivera à Londres qu'au printemps 1726 et se posera en rivale de la Cuzzoni.
Un nouvel opéra, Alessandro doit permettre de rassembler les deux prime donne rivales et Senesino dans le même ouvrage, mais dans l'attente de la Bordoni, Haendel interrompt son travail et compose en trois semaines Scipione, présenté le 12 mars 1726 ; Alessandro est ensuite créé le 5 mai.
La rivalité des deux femmes et des factions qui les soutiennent dégradent l'ambiance et l'extravagance des cachets payés aux artistes commencent à causer des difficultés financières à l'Academy dont les souscripteurs sont de plus en plus mis à contribution, préparant une fin prévisible. Le 31 janvier 1727, Admeto pour lequel Haendel a ménagé des rôles d'importance égale pour les deux cantatrices remporte un énorme succès avec 19 représentations suivies de 9 autres pendant la saison suivante
.
Le 6 juin de cette même année voit les deux cantatrices rivales en venir aux mains sur scène en présence de la Princesse de Galles lors d'une représentation de l' Astianatte de Bononcini : énorme scandale qui ne fait que précipiter la fin de l'entreprise ; malgré la présentation de trois nouveaux opéras de Haendel : Riccardo Primo (11 novembre 1727), Siroe (17 février 1728) et Tolomeo (30 avril 1728), la saison 1727-1728 est la dernière de l' Academy. Elle ferme ses portes le 1er juin sur une ultime représentation d' Admeto
.
» de la Royal Academy of Music et le succès sans précédent du Beggar's Opera, satire écrite en réaction à la prééminence de l'opéra italien la position de Haendel et sa réputation sont dorénavant fermement établies. En février 1727, il sollicite et obtient la nationalité anglaise. Le roi George Ier meurt le 11 juin suivant lors d'un voyage en Allemagne : c'est Haendel qui compose les grandioses Coronation Anthems pour le couronnement de son successeur, George II (l'une de ces antiennes, Zadok the Priest, est interprétée depuis lors pour chaque couronnement). Ses compositions sont connues et suivies à l'étranger, ses opéras régulièrement montés à Hambourg, à Brunswick ...
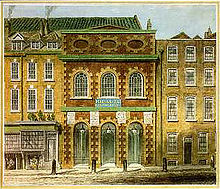
Le Queen's Theatre du Haymarket à Londres. La plupart des opéras de Haendel y furent représentés.
1730-1733 : La seconde Academy
Repartant sur de nouvelles bases financières et d'organisation, Haendel et Heidegger poursuivent leur activité pour une durée initialement prévue pour cinq ans. Les directeurs de l'Académie leur cèdent le King's Theatre et leur prêtent les décors, costumes et machines utilisables
.
Aucune représentation n'a lieu en 1728-1729, mais Heidegger puis Haendel font tour à tour un voyage en Italie pour y embaucher de nouveaux chanteurs. Farinelli, un temps pressenti, n'est finalement pas engagé. Haendel se rend au moins à Venise et à Rome ou il retrouve ou est invité par des cardinaux d'ancienne connaissance, peut-être à Milan, Florence, Sienne ou Naples ; repassant par l'Allemagne sur le chemin du retour, il revoit Halle en juin, et pour la dernière fois, sa mère devenue aveugle et qui décèdera l'année suivante (le 27 décembre 1730) ; une invitation à Leipzig chez Johann Sebastian Bach lui est transmise par le fils de celui-ci, Wilhelm Friedemann, invitation à laquelle il ne se rend pas. Continuant par Hanovre et peut-être Hambourg (toutefois sans y visiter Mattheson), il est de retour à Londres fin juin 1729.
Le premier opéra présenté par la nouvelle troupe de chanteurs constituée est Lotario créé le 2 décembre mais qui n'a pas de succès. Une amie de longue date de Haendel, Mrs Pendarves analyse ainsi les causes de cet insuccès, l'imputant au manque de goût des spectateurs :
The present opera is disliked because it is too much studied, and they love nothing but minuets and ballads, in short The Beggar's Opera and Hurlothrumbo are only worthy of applause
On n'aime pas cet opéra parce qu'il est trop savant ; les gens n'apprécient que les menuets et ballades ; en bref, pour eux, seuls le Beggar's Opera et Hurlothrumbo valent d'être applaudis.
En outre, les spectateurs n'apprécient pas certains chanteurs que ce soit pour leur voix ou leur jeu de scène, notamment le remplaçant de Senesino, Antonio Bernacchi, ou la basse Riemschneider qui « prononce l'italien à la teutonne » et qui « joue comme un cochon de lait »
.
Partenope, nouvel opéra d'un caractère tout différent, dont la première a lieu le 27 février n'est pas mieux reçu. Haendel y tente pourtant de renouveler le genre de l'opera seria, introduisant des chœurs, un trio et même un quatuor dans cette œuvre sortant résolument de la catégorie de l'« opéra héroïque » qui a fait les beaux jours de la première Academy. Ces déboires et les difficultés financières qui s'ensuivent rendent tendues les relations avec Heidegger, et la saison lyrique est sauvée par la reprise de succès antérieurs, notamment Giulio Cesare, et grâce à une subvention royale. Des chanteurs quittent le troupe, Riemschneider et Bernacchi, que remplacera la saison suivante, Senesino revenu à Londres sur l'instigation de Francis Colman, un ami de Haendel consul à Florence et Owen Swiney, l'indélicat impresario qui avait emporté la caisse après les premières représentations de Teseo en 1713
.
En 1731 la seule création à l'opéra est Poro présenté le 2 février. Après Siroe, c'est le second opéra de Haendel fondé sur un livret de Métastase. Un librettiste non identifié a adapté pour Haendel le texte de Métastase, à cette époque le principal pourvoyeur de livrets d' opera seria de toute l'Italie. Poro est un succès, avec seize représentations puis quatre autres à la fin de l'année. Cette même année voit le piteux départ de Londres de l'ancien rival Giovanni Bononcini, confondu et ridiculisé dans une affaire de plagiat. La saison, avec des reprises, appréciées par le public, de plusieurs opéras antérieurs s'achève donc de façon favorable
.
1732 commence beaucoup moins bien : Ezio, également tiré de Métastase, est un des plus cuisants échecs de toute sa carrière : présenté le 15 janvier, il n'aura que 5 soirées et ne sera jamais repris par le compositeur. Sosarme terminé le 4 février et présenté le 15 fait au contraire salle comble, capitalisant sur une réduction importante des récitatifs qui lassent facilement le public anglais
.
Cette année 1732 est marquée, le 23 février (jour de ses 47 ans) par la reprise du drame biblique Esther dans sa version initiale datant de 1718, pour trois représentations privées : le succès rencontré suscite une représentation pirate qui pousse Haendel à réviser en profondeur la partition pour en faire un véritable oratorio (HWV 50b) dont la première exécution a lieu au King's Theatre à Haymarket le 2 mai 1732 et qui devient le prototype de l'oratorio anglais tel qu'il va en composer pendant le reste de sa carrière
.
Un scénario analogue se produit la même année, avec une reprise non autorisée d'une œuvre datant de l'époque de Cannons : Acis and Galatea. Haendel riposte en composant une seconde version qui incorpore des airs de sa cantate italienne Aci, Galatea e Polifemo mais reste sourd aux appels de plusieurs de ses amis et admirateurs, parmi lesquels Aaron Hill, d'avoir à ressusciter l'opéra en anglais délaissé depuis Purcell, tâche à laquelle plusieurs compositeurs rivaux mais moins talentueux s'attachent alors
.
Pour l'heure, Haendel prépare ce qui sera la dernière saison de la seconde Academy, et compose un de ses chefs-d'œuvre dans le domaine de l'opéra italien : Orlando, créé le 27 janvier 1733. Orlando renoue avec la veine de l'opéra « magique » qui avait fait le succès de Haendel aux début de son séjour en Angleterre (avec Rinaldo, Teseo et Amadigi), veine délaissée depuis de nombreuses années. L'opéra reçoit tout d'abord un accueil favorable, avec dix représentations, mais celles-ci s'arrêtent du fait de l'indisposition d'un chanteur et Senesino est bientôt congédié par Haendel : c'est la fin de la seconde Academy.
En 1733, il fonda une troisième Academy qui ne dura que trois ans, nonobstant l'énergie dépensée par le compositeur pour multiplier les nouvelles créations qui obtenaient parfois de grands succès. Il fut en effet confronté à la concurrence du Nobility Opera, animé par deux compositeurs, Hasse et Porpora. Difficultés financières, mésententes entre artistes, coteries provoquèrent la fin de cette entreprise de même que celle du Nobility Opera. Le surmenage fut sans doute la cause d'un premier accident de santé le 13 avril 1737 qui le paralysa partiellement et l'atteignit moralement. Mais il se rétablit très rapidement après une cure thermale à Aix-la-Chapelle en septembre 1737. Cette même année 1737, la reine Caroline mourut. Elle avait connu Haendel enfant à Berlin et avait été pour lui un soutien fidèle ; ce décès le toucha profondément ; il composa un Funeral Anthem en son hommage.
Haendel continua à composer, à exécuter et faire représenter des opéras, des concertos grossos, et il commença à exploiter la veine des oratorios, avec Saul et Israel in Egypt. En intermède de ses oratorios, il exécuta ses concertos pour orgue, forme originale qu'il mit au point. Ses concertos « rencontrèrent un éclatant succès ». Ils sont au nombre de seize, dont les six premiers furent publiés en 1738 sous le titre d'opus 4. L'opus 7, qui en rassemble six autres, fut publié en 1760 après la mort du compositeur. Ce fut en 1741 que Haendel produisit son dernier opéra, Deidamia. Dorénavant, il consacra sa production lyrique à l'oratorio et écrivit coup sur coup Le Messie (en anglais Messiah, un de ses plus grands chefs-d'œuvre), en août-septembre et Samson en octobre, puis il se rendit, sur l'invitation du lord lieutenant d'Irlande, à Dublin où il séjourna pendant plusieurs mois, jusqu'en août 1742 et où ses œuvres eurent de très grands succès.
De retour à Londres, il subit une seconde attaque de paralysie dont il se remit à nouveau. Il continua à composer de nombreux chefs-d'œuvre, dans le domaine de l'oratorio comme dans celui de la musique instrumentale. La Musique pour les feux d'artifice royaux (Music for the Royal Fireworks) est l'une de ses œuvres les plus connues et les plus populaires. Composée en 1749 pour célébrer le traité de paix mettant fin à la guerre de Succession d'Autriche, cette musique fastueuse est emblématique de l'art de Haendel. Elle se situe dans la tradition de l'école versaillaise de Jean-Baptiste Lully, Delalande, Mouret, Philidor et en constitue comme le couronnement par son caractère grandiose et solennel particulièrement adapté à l'exécution en plein air. Les dernières œuvres furent, à nouveau, des oratorios, mais la santé du musicien déclinait malgré les cures thermales. Il subit de nouvelles attaques paralysantes et devint aveugle « malgré l'intervention manquée de deux célèbres praticiens de l'époque, dont John Taylor. "Il continua malgré tout à s'intéresser à la vie musicale, et mourut le 14 avril 1759, jour du Samedi-Saint. Ses obsèques se déroulèrent devant 3 000 personnes. Il fut enterré à l'abbaye de Westminster, selon son désir.
À la mort de Haendel, sa fortune était évaluée à 20 000 £, somme considérable pour l'époque. Ne s'étant jamais marié, n'ayant donc pas eu de descendance, c'est sa nièce demeurée en Allemagne qui hérita en grande partie de lui. Néanmoins, il en légua une partie à des amis, ainsi qu'à des œuvres de bienfaisance.