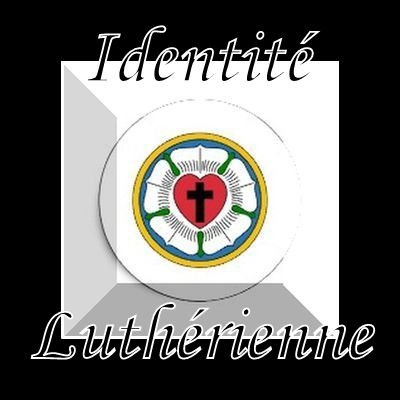A son cher fils Philippe, salut et amitié de père.
Cher fils, parce que je désire de tout mon cœur que tu sois bien enseigné en toutes choses, j’ai pensé que je te ferais quelques enseignements par cet écrit, car je t’ai entendu dire plusieurs fois que tu retiendrais davantage de moi que de tout autre.
Cher fils, je t’enseigne premièrement que tu aimes Dieu de tout ton cœur et de tout ton pouvoir, car sans cela personne ne peut rien valoir.
Tu dois te garder de toutes choses que tu penseras devoir lui déplaire et qui sont en ton pouvoir, et spécialement tu dois avoir cette volonté que tu ne fasses un péché mortel pour nulle chose qui puisse arriver, et qu’avant de faire un péché mortel avec connaissance, que tu souffrirais que l’on te coupe les jambes et les bras et que l’on t’enlève la vie par le plus cruel martyre.
Si Notre Seigneur t’envoie persécution, maladie ou autre souffrance, tu dois la supporter débonnairement, et tu dois l’en remercier et lui savoir bon gré car il faut comprendre qu’il l’a fait pour ton bien. De plus, tu dois penser que tu as mérité ceci- et encore plus s’il le voulait- parce que tu l’as peu aimé et peu servi, et parce que tu as fait beaucoup de choses contre sa volonté.
Si Notre Seigneur t’envoie prospérité, santé de corps ou autre chose, tu dois l’en remercier humblement et puis prendre garde qu’à cause de cela il ne t’arrive pas de malheur causé par orgueil ou par une autre faute, car c’est un très grand péché de guerroyer Notre Seigneur de ses dons.
Cher fils, je te conseille de prendre l’habitude de te confesser souvent et d’élire toujours des confesseurs qui soient non seulement pieux mais aussi suffisamment bien instruits, afin que tu sois enseigné par eux des choses que tu dois éviter et des choses que tu dois faire ; et sois toujours de telle disposition que des confesseurs et des amis osent t’enseigner et te corriger avec hardiesse.
Cher fils, je t’enseigne que tu entendes volontiers le service de la sainte Eglise, et quand tu seras à l’église garde-toi de perdre ton temps et de parler vaines paroles. Dis tes oraisons avec recueillement ou par bouche ou de pensée, et spécialement sois plus recueilli et plus attentif à l’oraison pendant que le corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ sera présent à la messe et puis aussi pendant un petit moment avant.
Cher fils, je t’enseigne que tu aies le cœur compatissant envers les pauvres et envers tous ceux que tu considèreras comme souffrant ou de cœur ou de corps , et selon ton pouvoir soulage-les volontiers ou de soutien moral ou d’aumônes.
Si tu as malaise de cœur, dis-le à ton confesseur ou à quelqu’un d’autre que tu prends pour un homme loyal capable de garder bien ton secret, parce qu’ainsi tu seras plus en paix, pourvu que ce soit, bien sûr, une chose dont tu peux parler.
Cher fils, recherche volontiers la compagnie des bonnes gens, soit des religieux, soit des laïcs, et évite la compagnie des mauvais. Parle volontiers avec les bons, et écoute volontiers parler de Notre Seigneur en sermons et en privé. Achète volontiers des indulgences.
Aime le bien en autrui et hais le mal.
Et ne souffre pas que l’on dise devant toi paroles qui puissent attirer gens à péché. N’écoute pas volontiers médire d’autrui.
Ne souffre d’aucune manière des paroles qui tournent contre Notre Seigneur, Notre-Dame ou des saints sans que tu prennes vengeance, et si le coupable est un clerc ou une grande personne que tu n’as pas le droit de punir, rapporte la chose à celui qui peut le punir.
Prends garde que tu sois si bon en toutes choses qu’il soit évident que tu reconnaisses les générosités et les honneurs que Notre Seigneur t’a faits de sorte que, s’il plaisait à Notre Seigneur que tu aies l’honneur de gouverner le royaume, que tu sois digne de recevoir l’onction avec laquelle les rois de France sont sacrés.
Cher fils, s’il advient que tu deviennes roi, prends soin d’avoir les qualités qui appartiennent aux rois, c’est-à-dire que tu sois si juste que, quoi qu’il arrive, tu ne t’écartes de la justice. Et s’il advient qu’il y ait querelle entre un pauvre et un riche, soutiens de préférence le pauvre contre le riche jusqu’à ce que tu saches la vérité, et quand tu la connaîtras, fais justice.
Et s’il advient que tu aies querelle contre quelqu’un d’autre, soutiens la querelle de l’adversaire devant ton conseil, et ne donne pas l’impression de trop aimer ta querelle jusqu’à ce que tu connaisses la vérité, car les membres de ton conseil pourraient craindre de parler contre toi, ce que tu ne dois pas vouloir
.
Si tu apprends que tu possèdes quelque chose à tort, soit de ton temps soit de celui de tes ancêtres, rends-la tout de suite toute grande que soit la chose, en terres, deniers ou autre chose. Si le problème est tellement épineux que tu n’en puisses savoir la vérité, arrive à une telle solution en consultant ton conseil de prud’hommes, que ton âme et celle de tes ancêtres soient en repos. Et si jamais tu entends dire que tes ancêtres aient fait restitution, prends toujours soin à savoir s’il en reste encore quelque chose à rendre, et si tu la trouves, rends-la immédiatement pour le salut de ton âme et de celles de tes ancêtres.
Sois bien diligent de protéger dans tes domaines toutes sortes de gens, surtout les gens de sainte Eglise ; défends qu’on ne leur fasse tort ni violence en leurs personnes ou en leurs biens. Et je veux te rappeler ici une parole que dit le roi Philippe, mon aïeul, comme quelqu’un de son conseil m’a dit l’avoir entendue. Le roi était un jour avec son conseil privé-comme l’était aussi celui qui m’a parlé de la chose- et quelques membres de son conseil lui disaient que les clercs lui faisaient grand tort et que l’on se demandait avec étonnement comment il le supportait. Et il répondit : « Je crois bien qu’ils me font grand tort ; mais, quand je pense aux honneurs que Notre Seigneur me fait, je préfère de beaucoup souffrir mon dommage, que faire chose par laquelle il arrive esclandre entre moi et sainte Eglise. » Je te rappelle ceci pour que tu ne sois pas trop dispos à croire autrui contre les personnes de sainte Eglise. Tu dois donc les honorer et les protéger afin qu’elles puissent faire le service de Notre Seigneur en paix.
Ainsi je t’enseigne que tu aimes principalement les religieux et que tu les secoures volontiers dans leurs besoins ; et ceux par qui tu crois que Notre Seigneur soit le plus honoré et servi, ceux-là aime plus que les autres.
Cher fils, je t’enseigne que tu aimes et honores ta mère, et que tu retiennes volontiers et observes ses bons enseignements, et sois enclin à croire ses bons conseils.
Aime tes frères et veuille toujours leur bien et leur avancement, et leur tiens lieu de père pour les enseigner à tous biens, mais prends garde que, par amour pour qui que ce soit, tu ne déclines de bien faire, ni ne fasses chose que tu ne doives.
Cher fils, je t’enseigne que les bénéfices de saint Eglise que tu auras à donner, que tu les donnes à bonnes personnes par grand conseil de prud’hommes ; et il me semble qu’il vaut mieux les donner à ceux qui n’ont aucunes prébendes qu’à ceux qui en ont déjà ; car si tu les cherches bien, tu trouveras assez de ceux qui n’ont rien et en qui le don sera bien employé.
Cher fils, je t’enseigne que tu te défendes, autant que tu pourras, d’avoir guerre avec nul chrétien ; et si l’on te fait tort, essaie plusieurs voies pour savoir si tu ne pourras trouver moyen de recouvrer ton droit avant de faire guerre, et fasse attention que ce soit pour éviter les péchés qui se font en guerre. Et s’il advient que tu doives la faire, ou parce qu’un de tes hommes manque en ta cour de s’emparer de ses droits, ou qu’il fasse tort à quelque église ou à quelque pauvre personne ou à qui que ce soit et ne veuille pas faire amende, ou pour n’importe quel autre cas raisonnable pour lequel il te faut faire la guerre, commande diligemment que les pauvres gens qui ne sont pas coupables de forfaiture soient protégés et que dommage ne leur vienne ni par incendie ni par autre chose ; car il te vaudrait mieux contraindre le malfaiteur en prenant ses possessions, ses villes ou ses châteaux par force de siège. Et garde que tu sois bien conseillé avant de déclarer la guerre, que la cause en soit tout à fait raisonnable, que tu aies bien averti le malfaiteur et que tu aies assez attendu, comme tu le devras.
Cher fils, je t’enseigne que les guerres et les luttes qui seront en ta terre ou entre tes hommes, que tu te donnes la peine, autant que tu le pourras, de les apaiser, car c’est une chose qui plaît beaucoup à Notre Seigneur. Et Monsieur saint Martin nous en a donné un très grand exemple car, au moment où il savait par Notre Seigneur qu’il devait mourir, il est allé faire la paix entre les clercs de son archevêché, et il lui a semblé en le faisant qu’il mettait bonne fin à sa vie.
Cher fils, prends garde diligemment qu’il y ait bons baillis et bons prévôts en ta terre, et fais souvent prendre garde qu’ils fassent bien justice et qu’ils ne fassent à autrui tort ni chose qu’ils ne doivent. De même, ceux qui sont en ton hôtel, fais prendre garde qu’ils ne fassent injustice à personne car, combien que tu dois haïr le mal qui existe en autrui, tu dois haïr davantage celui qui viendrait de ceux qui auraient reçu leur pouvoir de toi, et tu dois garder et défendre davantage que cela n’advienne.
Cher fils, donne volontiers pouvoir aux gens de bonne volonté qui en sachent bien user, et mets grande peine à ce que les péchés soient supprimés en ta terre, c’est-à-dire les vilains serments et toute chose qui se fait ou se dit contre Dieu ou Notre-Dame ou les saints : péchés de corps, jeux de dés, tavernes ou autres péchés. Fais abattre tout ceci en ta terre sagement et en bonne manière. Fais chasser les hérétiques et les autres mauvais gens de ta terre autant que tu le pourras en requérant comme il le faut le sage conseil des bonnes gens afin que ta terre en soit purgée.
Avance le bien par tout ton pouvoir ; mets grande peine à ce que tu saches reconnaître les bontés que Notre Seigneur t’auras faites et que tu l’en saches remercier.
Cher fils, je t’enseigne que tu aies une solide intention que les deniers que tu dépenseras soient dépensés à bon usage et qu’ils soient levés justement. Et c’est un sens que je voudrais beaucoup que tu eusses, c’est-à-dire que tu te gardasses de dépenses frivoles et de perceptions injustes et que tes deniers fussent justement levés et bien employés-et c’est ce même sens que t’enseigne Notre Seigneur avec les autres sens qui te sont profitables et convenables.
Cher fils, je te prie que, s’il plaît à Notre Seigneur que je trépasse de cette vie avant toi, que tu me fasses aider par messes et par autres oraisons et que tu demandes prières pour mon âme auprès des ordres religieux du royaume de France, et que tu entendes dans tout ce que tu feras de bon, que Notre Seigneur m’y donne part.
Cher fils, je te donne toute la bénédiction qu’un père peut et doit donner à son fils, et je prie Notre Seigneur Dieu Jésus-Christ que, par sa grande miséricorde et par les prières et par les mérites de sa bienheureuse mère, la Vierge Marie, et des anges et des archanges, de tous les saints et de toutes les saintes, il te garde et te défende que tu ne fasses chose qui soit contre sa volonté, et qu’il te donne grâce de faire sa volonté afin qu’il soit servi et honoré par toi ; et puisse-t-il accorder à toi et à moi, par sa grande générosité, qu’après cette mortelle vie nous puissions venir à lui pour la vie éternelle, là où nous puissions le voir, aimer et louer sans fin, Amen.
A lui soit gloire, honneur et louange, qui est un Dieu avec le Père et le Saint-Esprit, sans commencement et sans fin . Amen.